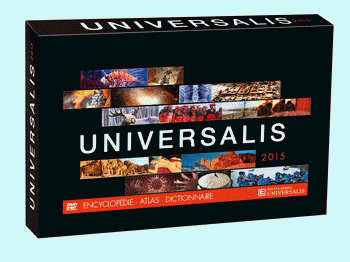FOI
Prise de vue
Dans le vocabulaire actuel, le mot « foi » désigne habituellement une croyance religieuse ou une croyance morale, c’est-à-dire l’engagement d’un individu au service d’un idéal auquel il croit.Nous avons cependant conservé une autre acception du mot : la bonne foi, synonyme de sincérité, de loyauté. Cette seconde acception se retrouve principalement dans les contextes juridiques. Par exemple, « faire une déclaration sous la foi du serment » ; juger qu’un témoin est « digne de foi » ou qu’un document « fait foi », c’est-à-dire peut servir de preuve en cas de contestation. Nous avons donc une distinction à faire entre la foi-croyance et la foi-loyauté. Quel rapport y a-t-il entre les deux ? L’évolution des mœurs nous porte aujourd’hui à traiter séparément les deux notions.Pourtant au XVIIe siècle existaient encore de nombreuses expressions où le mot foi indiquait non pas ce que l’on croit mais ce qui est crédible et mérite confiance. Nous ne disons plus guère : « par ma foi ; engager sa foi ; la foi du mariage ; la foi jurée ; etc. ». Ces formules ont vieilli ; elles tenaient leur signification de pratiques rituelles issues du Moyen Âge ou de l’Antiquité. Nous avons perdu l’habitude d’associer le mot foi à la crédibilité ou à la fiabilité ; nous l’associons plus spontanément à la croyance, à la conviction affirmée. Par exemple, les membres d’une communauté religieuse sont appelés aujourd’hui des croyants alors que la tradition les désignait comme des fidèles, ce qui veut dire que la foi-croyance était elle-même comprise comme une loyauté à l’égard des engagements pris, un attachement sincère et donc fiable à la tradition commune.
Nous verrons qu’il est possible de construire un modèle théorique qui rende compte des divers usages du mot foi. Ce modèle théorique peut se formuler de la manière suivante.La foi est l’engagement d’une relation de confiance entre deux personnes (humaines ou divines). Cette relation peut s’entendre au sens actif (la confiance que je fais) ou au sens passif (la confiance qui m’est faite). Au sens actif, la foi est ce qui me rend croyant, confiant. Au sens passif, la foi est ce qui me rend crédible, fiable. Dans cette double acception active et passive, la foi est la vertu du témoignage, l’honneur d’une parole non seulement donnée mais reçue.
Ce modèle théorique servira de fil conducteur pour éviter de se perdre dans les méandres de l’histoire. En effet, notre concept de foi a recueilli en lui un triple héritage :le latin fidesle grec pistis et l’hébreu emounah. En examinant ce triple héritage, nous verrons que le latin et l’hébreu tendaient à privilégier le sens passif de la foi-loyauté, celle qui rend fiable, bien que la conception du loyalisme soit radicalement différente suivant que la loyauté est acquise par le sens de l’État chez le citoyen romain ou par la fidélité à la Loi divine chez le juif pieux. Dans les deux cas, ce qui est mis au premier plan, c’est la foi qui rend fiable, la bonne foi, la loyauté de l’individu à l’égard de la société dans laquelle il vit, ce qui n’exclut pas que, secondairement, l’idée de la foi-croyance puisse être exprimée dans certains contextes particuliers.En revanche, dans le grec du Nouveau Testament, le sens actif de la foi qui rend croyant passe au premier plan à l’intérieur d’une théologie fortement élaborée. Alors que la piété rituelle était la vertu fondamentale des religions antiques, le christianisme a marqué son originalité en faisant de la foi la source de toutes les valeurs religieuses. L’émergence doctrinale de la foi-croyance en langue grecque avait été préparée par les philosophes et les rhéteurs lorsqu’ils avaient mis en discussion les « croyances » populaires. Il faut ajouter néanmoins que le grec du Nouveau Testament continue à véhiculer certaines valeurs du loyalisme juif, de sorte que l’influence de l’hébreu est toujours présente. Ce sont ces multiples interférences linguistiques et culturelles qui font la complexité sémantique de ce que nous appelons « la foi ». Telle est l’idée d’ensemble dont nous allons reprendre l’analyse détaillée.
1. Origine et sens du mot « foi »
Les mots latins fides (foi) et foedus (pacte, accord, alliance) proviennent d’une même racine indo-européenne, beidh-, qui a donné aussi en grec pistis et qui suggère d’une manière générale l’idée de confiance (cf. G. Dumézil, Idées romaines ; G. Freyburger, Fides. Étude sémantique et religieuse). La foi est un engagement durable de la confiance, suivant des formes variables telles que : parole donnée, promesse, profession de foi, serment, contrat, traité, alliance, conventions diverses. Du fait que la confiance se donne et se reçoit, la valeur du mot « foi » oscille entre le sens actif de « faire confiance » (avoir foi, avoir la foi) et le sens passif d’« inspirer confiance » (faire foi, être digne de foi, jouir d’un crédit, être fiable). La foi ne se réduit pas à la confiance ; elle l’oriente. Elle peut l’orienter en deux directions complémentaires : la foi que nous accordons à la parole d’autrui ou à son témoignage oriente vers lui notre confiance (sens actif) ; la bonne foi, l’intention droite, oriente vers nous la confiance (sens passif), elle nous vaut un crédit moral. Sous ces deux directions opposées (la foi qui nous rend confiants, la foi qui nous rend fiables), on peut reconnaître l’exigence d’une relation réciproque entre les personnes diversement concernées par les enjeux de la foi. La parole donnée engage une relation réciproque entre la loyauté de l’un et la confiance de l’autre. En donnant sa foi, on se donne soi-même à reconnaître. Tu ne peux avoir qu’une parole ; il y va de toi. Les nombreuses références données par le dictionnaire de Littré montrent qu’à l’âge classique le mot « foi » pose la base personnelle d’un lien social et sert à exprimer toutes les formes de loyalisme : la foi de l’amitié, la foi en amour, la foi du mariage, la foi promise, la foi jurée, la foi des traités, la foi patriotique, la foi d’honnête homme et la foi de Bohême (celle que les voleurs se gardent entre eux), la foi en autrui, la foi en soi-même... Dans tous ces cas, la foi est distincte du concept de croyance ; elle est comme un pacte que l’on fait avec soi-même ou avec autrui ; elle implique la loyauté dans les conventions et la fidélité aux engagements pris. Comme on le verra, c’est la civilisation romaine de l’Antiquité qui, par l’intermédiaire du Moyen Âge, nous a transmis cette idée de la foi comme vertu de loyauté, la bonne foi.
La foi chrétienne est plus complexe, puisqu’elle introduit une croyance religieuse dans les liens de fidélité à la parole donnée : fidélité de Dieu à sa Parole (c’est-à-dire à la promesse du salut accomplie dans la résurrection du Christ) et fidélité du chrétien à sa profession de foi (promesses du baptême). Aujourd’hui, on a tendance à projeter l’idéologie chrétienne sur les autres religions en considérant toute croyance religieuse comme une foi. C’est une erreur qui empêche de comprendre l’histoire des religions ; chaque religion doit être analysée en fonction de son propre vocabulaire. Cette question de vocabulaire est particulièrement importante lorsqu’on traite des rapports entre le judaïsme et le christianisme ou l’islam. Car l’ancienne religion d’Israël ne concevait pas la croyance en Dieu comme une foi, au sens que ce mot a pris chez les chrétiens dans le cadre du judaïsme hellénistique sous l’occupation romaine. Aujourd’hui encore, on peut constater que l’Encyclopedia Judaica (publiée en anglais en 1971) ne contient pas d’entrée Faith, mais seulement Belief (« croyance » en général) et Articles of faith (à titre d’expression médiévale utilisée par certains rabbins pour dresser une liste des principales croyances juives). Les rédacteurs de cette encyclopédie affirment que l’enseignement biblique ne contient aucune injonction à croire, aucune prescription de ce que le christianisme et l’islam appellent « la foi ». En réalité, on peut bien trouver dans la Bible des injonctions à croire, mais il s’agit là d’une injonction à demeurer fidèle à l’Alliance que Dieu a conclue avec le peuple d’Israël ; la fidélité d’Israël est donc l’expression d’un loyalisme religieux ethnique, qui consiste à observer la Loi que Dieu a révélée à son peuple. C’est pour cela que les théologiens chrétiens ont toujours distingué la Loi de l’Ancien Testament et la Foi du Nouveau, Lex et Fides. L’histoire des origines chrétiennes, comme on le verra, est l’histoire d’une transformation du concept de fidélité : la Bonne Nouvelle de l’avènement messianique, n’ayant pas été reçue par le peuple d’Israël, comme dira saint Paul, va devenir, au cours du Ier siècle, le point de départ d’une nouvelle forme de religion, une religion dans laquelle on entre par conversion individuelle, indépendamment des appartenances ethniques. La forme de la religion a changé : elle n’est pas ethnique (nationale) mais « congrégationnelle » (une assemblée de croyants, l’Église). Lorsque les chrétiens parlent de « la foi d’Abraham », ils interprètent l’Ancien Testament non pas « suivant la lettre » mais « suivant l’Esprit ».
Cette interprétation spirituelle sera reprise ensuite par l’islam. Celui-ci interprétera l’idée biblique d’alliance sous la forme d’une alliance céleste, d’une alliance éternelle qui se passe dans le ciel. L’expression « alliance éternelle » se trouvait déjà dans la Bible. Mais cette expression a été surtout utilisée dans le culte. À mesure que se développait dans le rabbinisme et le christianisme la pratique de la lecture des saintes Écritures, l’intelligence de la foi se tournait vers la contemplation des réalités célestes, éternelles, au-delà du monde sensible. C’est en conformité avec cette pratique rituelle de la lecture que l’islam a conçu la fonction du prophète ; Dieu commanda à Muhammad de répéter sur la terre les paroles « écrites dans le ciel ». Le Prophète-lecteur inaugura une nouvelle conception de la fidélité, la religion du Livre.
De ces remarques générales découle une méthode d’analyse, qui nous amènera à étudier d’abord les valeurs de Fides dans la civilisation romaine, puisque c’est de là que vient notre mot « foi », puis dans le vocabulaire hébraïque, les valeurs de fidélité à l’alliance divine dans la Bible. L’influence de ces deux civilisations se retrouve aujourd’hui dans notre vocabulaire lorsque nous distinguons la bonne foi et la foi en Dieu. Les deux conceptions de la foi comme loyauté et comme croyance nous ont été transmises par le mot fides en latin médiéval. La rencontre entre la civilisation juive et la civilisation hellénistique (gréco-romaine) s’était déjà produite au IIIe siècle avant J.-C. lorsque les juifs alexandrins (les « Septante ») avaient traduit la Bible en grec. Au cours du Ier siècle après J.-C., la langue grecque est devenue la langue dans laquelle s’est diffusé le christianisme. Le mot grec pistis a servi à exprimer la foi messianique, qui s’est peu à peu distinguée de la fidélité à la Loi juive. Ainsi s’est formée « la tradition apostolique » reconnue (bien que de manières différentes) par les catholiques et les protestants comme la source de la prédication et de la discipline dans l’Église. Nous aurons donc à étudier comment le christianisme a transformé l’idée de foi ; il en a fait une croyance pour laquelle on témoigne, alors qu’originellement la foi (la bonne foi) était la rectitude qui conditionne l’existence (la validité morale) d’un témoignage, quel qu’il soit. De fait, la foi chrétienne elle-même présuppose à sa source un témoignage, celui des Prophètes, de Jésus, des Apôtres. Notre étude historique nous conduira donc à reprendre par la base la philosophie du témoignage, puisque, en toute hypothèse, l’idée de témoignage est première et celle de croyance secondaire. La croyance est une affaire historique, alors que la sincérité conditionne universellement, moralement, la crédibilité. Y a-t-il un sens moral du mot « foi » ? Lequel ? L’histoire nous montrera que cette question est inéluctable.
2. « Fides » et « foedus » dans l’Antiquité romaine
Quelles étaient les valeurs de la fides chez le peuple romain avant l’apparition du christianisme ? Nous adopterons comme fil directeur de notre analyse l’hypothèse formulée jadis par M. Voigt (« Die Begriffe von Fides », in Jus naturale, IV, Leipzig, 1875) et complétée depuis par G. Dumézil et G. Freyburger. L’idée essentielle, que nous avons déjà mentionnée, est la suivante : le terme fides est un terme de relation ; il détermine entre les hommes une relation qui oriente la confiance soit dans une direction active (la confiance que je fais ou que j’accorde), soit dans une direction passive (la confiance que j’obtiens ou que je mérite), les deux directions pouvant d’ailleurs être suggérées à des degrés divers dans une même phrase.
Au sens actif, habere fidem, par exemple, signifie « avoir foi en quelqu’un, avoir confiance en quelqu’un ». Il ne faut pas confondre cette expression avec celle que nos habitudes actuelles de penser nous invitent à formuler en profitant des facilités que donne l’article en français : « avoir la foi ». Cette dernière formule a un sens attributif plutôt que relationnel (on attribue à quelqu’un une conviction). Nous ne sommes que trop portés aujourd’hui à imaginer « la » foi comme quelque chose que l’on a ou que l’on n’a pas ; il vaut mieux laisser de côté provisoirement ce sens attributif jusqu’à ce que nous soyons en mesure de l’expliquer. Les valeurs relationnelles sont plus fondamentales, même lorsqu’on privilégie le sens actif en direction d’autrui (« je vous crois, je vous fais confiance »).
Il faut regarder dans l’autre direction (le sens passif) pour comprendre comment la fides a pu devenir une vertu morale, « celle que les Romains ont le mieux et le plus cultivée », comme dit Aulu-Gelle (Nuits attiques, XX, I, 19). La fides est comprise comme une vertu morale sur la base d’une norme sociale, d’une règle des mœurs suivant laquelle la confiance obtenue, le crédit moral (sens passif) dont je suis digne dépend de ma loyauté, cette loyauté étant elle-même une valeur complexe qui inclut : la sincérité ou bonne foi ; le respect des lois (fides legum) ; le sens de la dignité (qu’en termes modernes nous appellerions un code de l’honneur).
La fides est donc avant tout la vertu de la fiabilité morale et civique ; elle conditionne la solidarité sociale dans le respect du droit (jus). C’est pourquoi Cicéron, traitant des vertus cardinales (prudence, justice, courage, tempérance), range la fides dans la catégorie de la justice : « Le fondement de la justice est la foi, c’est-à-dire la fidélité (constantia) et la véracité (veritas) dans les paroles et les conventions » (De officiis, I, 23). La foi est l’honnêteté qui mérite crédit : « Rien en effet ne maintient avec plus de force l’État que la foi [= crédit] qui ne peut exister sans la nécessité de payer ses dettes » (ibid., II, 24). L’historien grec Polybe estime que la supériorité des Romains sur les autres peuples vient de ce qu’ils ont su édifier sur la religion populaire une morale rationnelle : « En conséquence et sans parler du reste, quand un Grec manie des fonds publics, on a beau ne lui confier qu’un talent, et il peut bien avoir dix contreseings avec autant de cachets et le double de témoins, il est incapable de respecter son engagement ; les Romains, au contraire, qui manient de grosses sommes d’argent comme magistrats et comme légats, respectent leur devoir, du simple fait qu’ils sont engagés par serment. Alors qu’il est rare de trouver ailleurs un homme qui ne touche pas aux fonds d’État et garde les mains propres à cet égard, il est rare au contraire de rencontrer à Rome quelqu’un qu’on ait convaincu d’une pareille action » (Polybe, Histoires, VI, 56, 13-14). Les règles du droit ne peuvent s’appliquer sans faire appel à la raison et à la bonne foi, c’est-à-dire à un juste jugement des responsabilités de chacun : « Q. Scaevola, le grand pontife, disait qu’il y avait le plus de force dans tous les jugements où l’on ajoutait « ex bona fide » (en vertu de la bonne foi) et il pensait que la référence à la bonne foi s’étendait très largement, qu’elle se trouvait dans les tutelles, les associations, les questions fiduciaires, les mandats, les achats, les ventes, les locations demandées et les locations consenties, les affaires par lesquelles se maintient la vie en société » (Cicéron, De officiis, III, 70).
Dans les circonstances particulières, le foedus est l’engagement réciproque de la confiance. Une phrase d’Ennius (Ann., 32) en donne la définition : « Accipe daque fidem foedusque feri bene firmum [Reçois et donne la foi, qu’un pacte soit conclu bien ferme]. » Les formes sociales qui engagent la foi peuvent être simples ou solennelles : la parole donnée, la promesse (la foi promise dans le mariage, l’amitié, l’hospitalité), enfin la foi jurée – serment militaire (sacramentum), serment du magistrat qui entre en fonction, serment judiciaire du juge et des témoins. Le symbole par excellence de la foi promise est la jonction des mains droites, la poignée de mains ; le geste du serment est la main levée, parfois tenant l’épée. La déesse Fides a la main droite voilée en signe de consécration. Les dieux témoins du contrat sont spécialement ceux qui, selon G. Dumézil, représentent les deux faces, violente et paisible, de la fonction souveraine : Juppiter et Fides (anciennement Dius Fidius). Le parjure encourt les foudres de Juppiter, mais la paisible Fides n’a qu’une sanction : l’abandon. Abandonné de Fides, le perfide est discrédité, voué au mépris de ses concitoyens, sans crédit et sans protection. La foi romaine n’est pas religieuse par son objet, mais par son contexte : dans tout foedus conclu entre deux partenaires, même dans le secret, intervient la garantie d’un tiers, à savoir celle de la divinité dont le peuple romain reconnaît la présence constante au milieu de lui par le témoignage des sacra et des auguria. C’est au roi Numa que la légende attribuait l’institution de cette garantie religieuse comme un principe de gouvernement.
La fides a aussi le sens d’une assurance de protection. « Le latin est la seule langue indo-européenne à présenter cette acception » (G. Freyburger, pp. 67-74). L’origine antique de cette acception pourrait être attestée par l’existence du verbe quiritare : « Le verbe quiritare se dit de celui qui implore en criant la foi des Quirites » (Varron, De lingua latina, VI, 68). Lorsque le décemvir Appius voulut « par fraude » réduire en esclavage la fiancée d’Icilius et la prendre pour maîtresse, Icilius en appela à la deorum hominumque fidem, à la protection (fiabilité) des dieux et des hommes (Tite-Live, III, 45). Virginius, le père de la fiancée, préféra tuer sa fille plutôt que de la livrer au déshonneur, puis fit appel à l’appui de ses frères d’armes (liés à lui par le serment militaire). Cet incident mit fin au régime des décemvirs, comme la mort de Lucrèce (qui, elle aussi, avait fait appel à la fides) marqua la fin de la royauté. La fonction protectrice de la fides n’a pas seulement une signification morale, mais aussi une signification institutionnelle. La clientèle d’un puissant personnage se range sous son patronage, sous la protection de sa fides. Une idée semblable se retrouve dans les rapports d’hospitalité et les relations diplomatiques. Le latin médiéval conservera cette notion de fides comme promesse de sauvegarde (J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon). Les Grecs eurent quelque difficulté à comprendre la mentalité romaine sur ce point. Les Étoliens, en 191, « se donnèrent eux-mêmes à la foi des Romains, sans en comprendre le sens, induits en erreur par le mot pistis. Chez les Romains, cela revient au même de joindre les mains pour la foi et de se soumettre à la tutelle du puissant » (Polybe, XX, IX, II). La fides romaine n’est pas la concorde grecque, l’entente cordiale ; elle est une vertu aristocratique, inséparable du sens de l’État. Le vaincu qui se donne à la fides du vainqueur n’a aucun droit, tant que la jonction des mains droites, accueillant sa supplication, n’est pas suivie d’un foedus, d’un traité en bonne et due forme. Cependant, il appartenait à la dignité romaine de sauvegarder son crédit : le don de la main droite garantit au vaincu sa condition d’homme libre (car on ne joint pas sa main à celle d’un esclave sinon pour l’affranchir). Pour inciter les ennemis à se rendre, les Romains surent user avec intelligence de leur réputation de loyauté, de fiabilité. D’illustres exemples étaient destinés à rappeler qu’on doit garder la foi, même envers les ennemis. Telle la réponse de Camille au maître d’école de Faléries proposant au dictateur romain de lui livrer les enfants en otages pour faire céder la ville assiégée. Camille rejette violemment ce « présent scélérat » ; il rappelle que, s’il n’y a pas d’alliance entre les Romains et les Falisques, il existe un droit de la guerre comme de la paix. Le maître d’école, dépouillé de ses vêtements, les mains liées derrière le dos, fut reconduit en ville par les enfants à qui le dictateur avait donné des verges pour fouetter le traître en chemin. Frappée d’admiration par ce geste, la ville se rendit, les ennemis ayant été vaincus non par les armes, mais par la justice et la foi (justitia fideque hostibus victis) [Tite-Live, V, 27-28]. Telle était du moins l’idéologie romaine, illustrée par de nombreux exemples analogues. L’histoire de Regulus, que les Carthaginois firent prisonnier, puis qu’ils envoyèrent en mission à Rome sous serment de revenir, et qui revint, en effet, mourir à Carthage sous des supplices raffinés, cette histoire inspire à Cicéron des réflexions philosophiques dont la conclusion est la suivante : « C’est son retour à Carthage qui maintenant nous étonne le plus ; à la vérité, en ce temps-là, il n’aurait pu faire autrement ; c’est non pas lui mais son époque qui en a le mérite : nos ancêtres voulaient qu’il n’y ait pas de lien
plus solide que le serment pour engager la foi ; c’est ce que montrent les lois contenues dans les douze Tables, les lois dites sacrées, les traités qui engagent notre parole même envers l’ennemi, la jurisprudence des censeurs et les peines infligées par eux ; car il n’est rien qu’ils mettaient plus de soin à juger que le respect des serments » (De officiis, III, 111).
Les règles du jeu étaient strictes. Nul ne pouvait engager la fides publica sans le consentement exprès du Sénat. Des chefs militaires furent livrés aux ennemis pour avoir enfreint les règles de la foi publique, en agissant de leur propre autorité sans le consentement du peuple et du Sénat. Lors de la guerre des Samnites, les tribuns qui se trouvèrent dans ce cas furent livrés aux ennemis : « Et Postumius lui-même, l’un des tribuns livrés, se fit le conseiller et le promoteur de cette mesure. Et C. Mancinus, bien des années après, fit la même chose : avec les Numantins, il avait, sans l’aveu du Sénat, conclu un pacte, et c’est lui qui appuya le projet de leur être lui-même livré, projet que présentaient, en vertu d’un sénatus consulte, L. Furius et S. Attilius. Le projet adopté, il fut livré à l’ennemi » (De officiis, III, 109).
Le collège des prêtres de Fides, les féciaux, avait pour mission de faire respecter la justice et la foi dans la manière d’entrer en guerre et dans le respect des traités. C’est dans les relations internationales surtout qu’apparaît la grandeur morale et politique de cette valeur faite de loyauté et de dignité que les Romains nomment fides. Il fallait bien qu’il y eût quelque puissant ressort interne dans les mœurs de ce peuple qui, suivant le mot de Polybe, « conquit presque tout le monde habité en moins de cinquante-trois ans » (I, I).
Ajoutons qu’à l’âge classique le mot grec pistis peut, comme fides, signifier la confiance non seulement au sens actif mais également au sens passif : crédit, loyauté, bonne foi, fidélité, promesse, serment, garantie, caution, gage, preuve. Il y a cependant une valeur décisive que pistis ne possède pas, celle qui est propre à « la foi des Quirites », à savoir l’idée d’une protection que chaque citoyen, dans un moment de danger ou de crise grave, est en droit de demander à ses concitoyens au nom des liens sacrés qui les unissent. Cette dernière conception paraît profondément liée aux mœurs et aux institutions de la Rome républicaine.
3. Alliance et fidélité dans la Bible
Nous avons pris l’habitude de parler globalement de « la foi biblique », de « la foi chrétienne », de « la foi juive »..., en supposant que le mot « foi » résume la totalité du rapport de l’homme à Dieu. Il n’existe pas de mot en hébreu qui corresponde à cette acception. Les seuls termes capables d’évoquer dans sa totalité le message biblique sont ceux qui se rapportent non pas aux attitudes de l’homme, mais à l’œuvre de Dieu. Le Moyen Âge voyait dans l’Écriture la révélation du droit divin, Jus divinum. C’est à peu près dans le même sens qu’en hébreu moderne on emploie le mot dath pour désigner la religion.
L’ordre divin révélé dans l’Écriture s’organise autour d’une idée centrale : l’alliance de Dieu avec le peuple élu. Le mot hébreu berith peut se traduire « pacte d’alliance » (foedus) ou « serment » (sacramentum), avec cependant une nuance importante qui met l’accent sur les obligations résultant des engagements pris. Cette nuance légaliste est évoquée par les traductions grecque (diathékè) et latine (testamentum), qui soulignent que l’Écriture, à la manière d’un Testament, est le décret définitif, l’expression dernière de la volonté divine, car c’est Dieu qui a engagé la véracité de sa parole dans l’élection d’Abraham et dans la loi de l’alliance promulguée par Moïse. Il faut insister sur ces deux points pour comprendre les enjeux et les formes du loyalisme dans l’Ancien Testament. Dans l’élection d’Abraham, il y va de l’existence même d’une race élue, issue d’un couple stérile. Dans l’alliance mosaïque, l’enjeu est différent : c’est un rapport de suzerain à vassal qui s’établit entre Dieu et Israël. L’archéologie, en effet, éclaire la nature de la berith (en accadien biritu). En 1954, G. Mandenhall a montré qu’un traité hittite (XIVe-XIIIe s. av. J.-C.) avait la composition suivante : après nomination des titulaires 1o introduction historique motivant la loyauté exigée du vassal ; 2o stipulations du traité ; 3o liste des témoins divins ; 4o bénédictions et malédictions ; 5o promulgation publique du traité enregistré sur des tablettes. On retrouve une structure analogue dans Exode, XIX-XXIV : 1o introduction historique, XIX, 4-6 ; 2o lois, XX-XXIII, 19 ; 3o promesses et menaces, XXIII, 20-23 ; 4o proclamation publique de l’alliance, XXIV, 1-8. Des traités plus récents, comme celui d’Esarhadon avec ses vassaux orientaux, sont comparables par leur date et leur composition à la structure du Deutéronome : 1o introduction historique (Deut., I-II) ; 2o lois, XII, 1-XXVI, 15 ; 3o obligations mutuelles, XXVI, 16-19 ; 4o bénédictions et malédictions, XXVII-XXIX. Yahwé est donc le suzerain d’Israël, il lui a donné sa loi.
Le vocabulaire du loyalisme, en Israël, comporte un certain nombre de termes dont les principaux (mais non les seuls) se trouvent dans les dérivés de la racine aman (dont on connaît la forme optative Amen, qui est prononcée à la fin de la prière). L’idée générale semble être celle de stabilité, de garantie durable, de support, sur quoi on puisse s’appuyer comme sur une base sûre (cf. le « Rocher » d’Israël). Cependant, les dérivés de cette racine doivent être étudiés pour eux-mêmes dans la variété de leurs emplois. Chaque unité morphologique est syntaxiquement définie par un champ sémantique qui est l’ensemble de ses valeurs d’usage. C’est Ludwig Bach qui, en 1900, introduisit les méthodes d’analyse sémantiques dans ce qu’il appelait alors « l’intuition de la foi dans l’Ancien Testament ». Une racine hébraïque donne à la fois des formes nominales et des formes verbales. Nous étudierons d’abord les formes nominales : ’emunah (que la version alexandrine des Septante traduit souvent par pistis) et ’emeth (traduit par alèthéia, vérité). Parmi les divers aspects du verbe, signalons simplement que l’aspect qal ne s’emploie qu’au participe présent (’omen) pour désigner les parents nourriciers ; le niphal (ne’eman) exprime la stabilité, le durable, par exemple la stabilité promise à la maison de David, la dynastie royale, dans le IIe livre de Samuel, VII, 16, ou encore la constante validité des ordonnances divines (Ps., XIX, 8 ; XCIII, 5 ; CXI, 7). Le hiphil exprime la confiance au sens actif, nous l’étudierons après les formes nominales.
Pour illustrer les emplois de ’emunah, nous donnerons quelques citations en faisant paraître en italique la traduction du mot. Dans le IIe livre des Rois, XXII, 7, il est dit que les travailleurs du temple font leur métier avec probité, consciencieusement. Les Proverbes opposent au menteur l’homme véridique dans ses paroles et loyal dans ses actes (Prov., XII, 17 ; XIV, 5). Jérémie cherche en vain un homme qui pratique la justice et soit sincère (Jér., V, 1). « Ils tendent l’arc de leur langue pour le mensonge et ce n’est pas dans la droiture qu’ils ont grandi » (Jér., IX, 2). On voit que ces emplois privilégient les valeurs de confiance au sens passif (celles qui attirent la confiance). Dans les Psaumes surtout, le sens de ’emunah prend de l’ampleur et devient l’expression par excellence de la fidélité à l’ordre divin : « J’ai choisi la voie de ta fidélité, j’ai assimilé tes jugements » (Ps., CXIX, 30). Il s’agit de savoir où placer sa confiance, non pas dans une vie de « mensonge », mais dans la voie de « Ta » fidélité. « Yahwé sauvegarde ceux qui sont fidèles, et punit à l’extrême les faiseurs d’orgueil » (Ps., XXXI, 24). Le célèbre texte d’Habacuc II, 4 que la Septante a traduit : « Le juste vit par sa foi » signifie que le juste vit de fidélité sincère, c’est-à-dire exactement de comportements conformes à ’emeth, la vérité. Car la vérité, dans la Bible, a généralement un sens normatif ; elle indique moins le fait que la conformité à ce qui doit être. En principe, ’emunah est une disposition intérieure, alors que ’emeth se rapporte à des paroles ou à des actes auxquels on peut se fier. Mais il y a souvent des glissements de sens entre les deux. Il semble que ’emeth est employé plus souvent à date ancienne, alors qu’il se fait rare dans le code sacerdotal. Une partie de ses valeurs est prise par ’emunah. Dieu est aussi bien un Dieu de vérité qu’un Dieu de ’emunah (Deut., XXXII, 4). Notez le parallélisme dans les deux vers suivants : « J’ai dit ta fidélité et ton secours, je n’ai pas caché ta grâce [Khesed] et ta vérité [’emeth] » (Ps., XL, 11). Le mot Khesed signifie en Dieu la grâce, chez l’homme la piété ; lorsqu’il est mis en conjonction avec vérité, il exprime la valeur propre de l’Alliance. La même valeur est exprimée, par parallélisme, dans le premier vers : « Ta fidélité et ton secours. » Dans le psaume CXLIII, 1, il est dit que Dieu répond à la supplication par son ’emunah ; on peut songer à la fides romaine accordée en réponse au suppliant ; de toute façon, il ne s’agit pas de dire que Dieu a « la foi » mais qu’il est fiable. La conjonction entre grâce et vérité devient, dans le psaume XCII, 3, la conjonction entre la grâce et la fidélité (’emunah) qui attire la confiance : « Il est bon [...] d’annoncer le matin ta grâce et ta fidélité la nuit. » C’est cela le sentiment de l’Alliance. Dans Néhémie X, 1, ceux qui sont retournés de l’exil de Babylone font entre eux un pacte de confiance ; ils coupent une ’amanah, ce qui est un mot très voisin de ’emunah (« couper » s’entend au sens de « décider », « conclure », suivant la vieille formule rituelle usitée en Grèce comme en Palestine : « couper un pacte ou un serment »).
C’est dans le verbe he’emin que nous trouvons l’expression de la confiance au sens actif. Il faut prendre garde, toutefois, que le verbe est intransitif ; on dit « se tenir ferme », « être en confiance ». Nous distinguerons trois constructions selon que le verbe s’emploie absolument ou qu’il est suivi de prépositions.
Isaïe emploie la première construction, le verbe seul, dans une situation dramatique : les Israéliens du Nord et les Araméens s’apprêtent à faire le siège de Jérusalem ; ils veulent détrôner Achaz. Celui-ci prend peur. « Alors son cœur et le cœur du peuple vacillèrent comme vacillent les arbres de la forêt sous le vent. » « Yahwé dit à Isaïe : Sors à la rencontre d’Achaz [...]. Tu lui diras : prends garde d’être calme et que ton cœur ne faiblisse pas » (Is., VII, 2-3). Donc le message est clair : il s’agit d’opposer à la crainte la confiance, le calme. Mais Isaïe est un poète ; il transmet le message par un jeu de mots du genre : « Si vous n’êtes pas fermes, vous ne serez pas raffermis » ou « Si vous n’êtes pas stables, vous ne serez pas stabilisés » (Is., VII, 9), faisant allusion à la stabilité promise à la maison de David. L’édition de la Bible dans la collection de la Pléiade traduit : « Si vous ne croyez pas, non, vous ne pourrez être stables. » Tel est bien le sens. Mais la Septante hellénise le passage pour l’édification des juifs alexandrins en écrivant : « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas » – traduction d’où est sortie la maxime augustinienne sur l’intelligence de la foi (P.L., XXXVII, c. 1552 et XXXVIII, c. 255, 258).
La deuxième construction fait suivre le verbe he’emin de la préposition be- et prend alors le sens d’« avoir confiance en quelqu’un ou quelque chose ». La troisième construction fait suivre le verbe de la préposition le- : « croire quelqu’un, tenir pour vrai ce qu’il dit ». Enfin, la conjonction khi donne la formule « croire que ». La grammaire n’impose pas la distinction entre deux sortes de foi, orthodoxie et orthopraxie. Elle permet de dire que l’on tient pour vraie ou pour valable une déclaration ; et il n’est pas difficile de trouver dans la Bible des proclamations impératives d’orthodoxie, comme dans Exode, IV, 5 ou dans le second Isaïe, XLII, 10. En outre, ces diverses constructions sont importantes pour comprendre les rapports entre phrases affirmatives et phrases négatives (« ne pas avoir confiance », « se méfier »). A. Jepsen (1970) a montré que, dans les contextes profanes, le verbe he’emin a une tonalité négative. Les Prophètes et les Livres sapientaux exhortent à ne pas mettre sa confiance dans les moyens humains mais en Dieu seul. Dans la Bible, les croyances reposent sur des « signes », des « témoignages ». Ces signes sont à la fois les miracles de l’Exode et les préceptes de la Loi énoncés par Moïse ; ce sont les signes prophétiques annonçant que Yahwé agit dans l’histoire pour châtier les péchés de son peuple et pour récompenser ici-bas ceux qui lui sont fidèles. Or quel est l’enjeu ? L’enjeu, c’est la vie dans l’alliance exclusive de Yahwé avec Israël, car Yahwé est un Dieu jaloux qui punit les fautes des pères jusqu’à la troisième génération et qui n’admet pas d’autre « Baal » devant lui : « Vos yeux ont vu ce qu’a fait Yahwé à Baal Peor quand tous les hommes qui étaient allés à la suite de Baal Peor, Yahwé, ton Dieu, les extermina du milieu de toi » (Deut., IV, 3). Moïse lui-même, pour avoir douté un instant, fut condamné à mourir avant d’entrer dans la Terre promise. L’enjeu, c’est à la fois la vie et le monothéisme : Dieu est unique en tant qu’il est identifié comme Dieu de l’Alliance. Comment identifier un dieu ? Un dieu s’était révélé à Abraham, sous le nom d’El, dans les pays du Nord ; un dieu s’était révélé à Moïse sous le nom de Yahwé au pays de Madian, dans le Sud. Les deux traditions élohiste et yahwiste coexistent encore dans la Bible ; mais ces deux divinités (ou ces deux révélations) n’en firent qu’une en vertu de l’Alliance. Moïse prend bien soin de le préciser quand il répond à la question « Qui t’envoie ? » : « Yahwé, Élohim de vos Pères, Élohim d’Abraham, Élohim d’Isaac et Élohim de Jacob, m’envoie vers vous » (Ex., III, 15). Le dieu des pères était bien le même que celui de la Loi. Tout le monde sait qu’un dieu ne doit être ni trop ni trop peu personnifié : s’il l’est trop, sa majesté se perd dans l’anecdote ; s’il l’est trop peu, on ne sait plus comment rendre un culte à un dieu sans passions, sans émois. Une personnalité divine doit rester rituelle, typique, vivante dans un culte. Le Dieu d’Abraham avait une personnalité juridique : il était le Dieu de l’Alliance. C’est par là qu’on l’identifiait, par là que le Dieu des armées put devenir le Dieu des Écritures, car il tient sa singularité d’un adjectif possessif : « Écoute, Israël : Yahwé, notre Dieu est le seul Yahwé » (Deut., VI, 4). La théologie de l’adjectif possessif (Mein Gott !) résume celle de l’Élection et de l’Alliance : « Vous n’irez pas à la suite d’autres dieux, dieux des peuples qui seront autour de
vous, car Yahwé, ton Dieu, au milieu de toi, est un Dieu jaloux ; la colère de Yahwé, ton Dieu, s’enflammerait contre toi et il t’exterminerait de la surface du sol » (Deut., VI, 14-15). « Car tu es un peuple saint pour Yahwé, ton Dieu ; c’est toi que Yahwé, ton Dieu, a choisi pour devenir son peuple de prédilection d’entre tous les peuples qui sont à la surface du sol » (Deut., VII, 6). L’adjectif possessif, qui va dans les deux sens (ton Dieu, mon peuple) comporte une règle stricte d’endogamie. Quelque temps après le retour de l’Exil, Esdras raconte comment il apprit la nouvelle de « l’abomination » des mariages mixtes avec les gens restés au pays : « Car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils, et la Race sainte a été mélangée aux peuples du pays. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à accomplir cette mauvaise action. Lorsque j’entendis cela, poursuit Esdras, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m’arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m’assis bouleversé » (Esdr., IX, 2-3 ; cf. Néh., X, 31). Israël devait accepter d’être un peuple séparé parce qu’il avait engagé sa confiance en Dieu seul. Cependant, le Dieu d’Israël se distingue radicalement de sa création. Cette distinction entre le Créateur et sa créature est la source des développements futurs qui se produiront dans le judaïsme rabbinique, le christianisme et l’islam.
4. Les deux pactes
Pour conclure ces analyses, reprenons la comparaison entre la formule romaine fides-foedus et la formule hébraïque ’emunah-berith. La comparaison peut s’appuyer sur le fait que l’on trouve dans l’histoire du peuple hébreu deux conceptions du pacte : une conception ancienne analogue à la formule romaine et une conception plus originale, propre à la religion d’Israël. L’intervention de la divinité n’est pas la même dans ces deux sortes de pactes. À date ancienne, chez les Hébreux, les Romains, les Grecs et bien d’autres, la divinité intervient en tiers entre les partenaires humains concluant un pacte ; elle intervient comme témoin invisible et garant des accords conclus entre les hommes (par exemple Gen., XXXII, 44 sqq.). Dans une forme plus typiquement juive, c’est un homme qui intervient comme médiateur de l’alliance entre le peuple d’Israël et Yahwé. Tel est le cas principalement de Moïse dans l’alliance sinaïtique, de Jésus dans le Nouveau Testament, de Muhammad dans l’alliance céleste dont parle le Coran. On notera que la théologie de l’alliance change suivant le rôle attribué au médiateur : législateur, messie ou prophète.
Lorsque la divinité sert de médiateur (dans la formule ancienne), elle garantit par des sanctions religieuses la fidélité des partenaires humains. En revanche, lorsque la divinité entre comme partenaire du pacte, le rapport d’alliance devient intrinsèquement religieux, théocentrique. La parole donnée par Dieu, la promesse divine, appelle en retour la fidélité de l’homme aux commandements divins. C’est cette seconde forme de pacte, essentiellement théocentrique, qui caractérise la révélation biblique, fondement de ce qui s’est appelé « la foi » en grec et en latin.
La traduction grecque de la Bible, dans la version des Septante (IIIe-IIe s. av. J.-C.), a été jugée sévèrement par le judaïsme rabbinique. Le mot « foi » est l’un de ces termes qui évoquent presque irrésistiblement une interprétation globale de la Bible, la foi messianique s’étant, chez les chrétiens, dissociée du légalisme. Nos traditions sont nées de traductions successives, de l’hébreu au grec, puis du grec au latin patristique et médiéval. « Il faut attendre le christianisme, écrit G. Dumézil, pour que, sous l’influence d’originaux hébraïques et grecs, credo et fides reçoivent les valeurs qui nous sont familières [...]. Il est piquant de voir le saint polémiste d’Hippone, qui vivait si intensément sa fides-croyance, la chercher, sans bien entendu la trouver, dans la fides-loyauté du panthéon païen et traiter celle-ci avec autant de liberté que n’importe quelle divinité romaine : « Pourquoi (écrit saint Augustin) ont-ils fait de la foi une déesse et lui ont-ils consacré un temple et un autel ? L’autel de la foi est dans le cœur de quiconque est assez éclairé pour la posséder. D’où savent-ils d’ailleurs ce que c’est que cette foi, dont le meilleur et le principal ouvrage est de faire croire au vrai Dieu ? » (Cité de Dieu, IV, 19) » (Idées romaines, p. 58, 1969). Dans ce texte s’affrontent deux civilisations, deux conceptions du pacte social. L’une honorait la bonne foi, la Bona Dea ; l’autre s’estimait assez éclairée pour posséder la vraie foi.
5. La source de la foi chrétienne
Le christianisme, à la différence de l’islam, s’est formé lentement. Jésus n’a pas fondé d’Église, il fallait attendre la venue de l’Esprit sur les Apôtres, ainsi que le rappelle la liturgie de la Pentecôte. Au cours du Ier siècle se sont affrontées, puis mêlées, des tendances judaïsantes et hellénisantes. Le résultat de cette évolution complexe a été en quelque sorte résumé dans l’idée de « la tradition apostolique », idée qui a présidé à la rédaction des Évangiles (après la ruine de Jérusalem), puis à la réunion des écrits du Nouveau Testament (au cours du IIe siècle). L’esprit chrétien doit son originalité à la complexité de ses origines, et il n’aurait pu conserver son unité sans une forte institution. La légende des douze Apôtres (comme les douze tribus d’Israël) symbolise le principe sur lequel repose la doctrine de l’Église, à savoir que la plénitude de la révélation a été transmise par les Apôtres. « Le Seigneur, écrit saint Irénée, a donné à ses Apôtres toute la puissance de l’Évangile. C’est par eux que nous connaissons la vérité qui est la doctrine du Fils de Dieu » (Adversus Haereses, III, 1, I). Puis : « La tradition vient des Apôtres et est conservée par la succession du ministère » (ibid., III, 3, I). Catholiques et protestants se distinguent par la manière de concevoir « la succession du ministère », mais nul ne met en question le principe de la tradition apostolique. Prétendre qu’avec les Apôtres la révélation n’est pas complète est une proposition condamnée par l’Église romaine (Denzinger, 2020). Le décret du concile de Trente, en date du 8 avril 1546, est sur ce point plus proche des thèses de la Réforme que ne l’est le IIe concile du Vatican. La IVe session du concile de Trente ne fait aucune référence aux traditions « ecclésiastiques » ; elle ne parle que des traditions « apostoliques » en rapport avec la succession du ministère exprimée par le rite d’imposition des mains « quasi per manus traditae » (Denzinger, 783). Seul est affirmé le double mode de transmission, scripturaire et pastoral, de l’Évangile « source de toute vérité salutaire et de toute discipline des mœurs ». Ce qui a été rejeté, en revanche, c’est le projet initial de décret qui parlait d’une révélation transmise en deux parties, écrites et non écrites ; les mots « partim... partim... » ont été éliminés de la rédaction définitive, le concile n’ayant pas voulu prendre position sur la question de savoir si les traditions non écrites (c’est-à-dire rituelles) avaient, à l’égard de l’Écriture, une valeur « complétive » ou seulement « interprétative ». Les écrivains de la Contre-Réforme ont interprété faussement ce décret en lui faisant dire qu’il y avait deux sources de la révélation, les Écritures et les Traditions. En fait, le compte rendu des débats conciliaires montre qu’on n’a pas envisagé autre chose que des traditions rituelles. Le décret ne reconnaît qu’une source (Fontem, au singulier), à savoir l’Évangile, dont la transmission est assurée conjointement par les Écritures et les traditions rituelles transmises « de la main à la main » (cf. E. Ortigues, « Écritures et traditions apostoliques au concile de Trente » ; Religions du livre et religions de la coutume). Entre le décret du 8 avril 1546 et les thèses de la Réforme, la différence porte uniquement sur la manière de concevoir « la succession apostolique ». Ce qui rend la situation paradoxale, c’est que, dans les deux confessions, la Règle de foi demeure l’interprétation de l’Écriture dans l’Église universelle.
6. La Loi et la Foi
Dans ses épîtres aux Galates et aux Romains, saint Paul oppose la Loi et la Foi, la lettre et l’Esprit. La rédemption par l’amour est la révélation de la loi nouvelle, la charité. Au moment où il écrit ses fameuses lettres (autour des années 50), le christianisme et le judaïsme n’étaient pas deux religions distinctes. Paul se dit lui-même pharisien, fils de pharisien ; et Luc, dans les Actes des Apôtres, soutient que Paul est resté fidèle observateur des « coutumes de ses pères » jusqu’à la fin de sa vie (Act., XXVIII, 17). Y a-t-il contradiction entre la thèse de Luc et les affirmations de Paul sur la caducité de la Loi ? Il ne le semble pas. Paul n’a pas dit que les juifs étaient dispensés d’observer la Loi, mais qu’ils n’avaient pas à l’imposer aux croyants venus de la gentilité. Il s’agit pour lui d’un débat interne au judaïsme. Il ne met pas en question « l’héritage » de ses pères, ni l’espoir d’une restauration d’Israël à la fin des temps, mais il pense que le salut doit passer par la conversion des païens : « Dieu est-il seulement le Dieu des juifs ? demande-t-il. N’est-il pas aussi le Dieu des gentils ? Oui, il est aussi le Dieu des gentils. Alors il n’y a qu’un seul Dieu qui justifie le circoncis par la foi et l’incirconcis par la foi. Abolissons-nous la Loi ? Absolument pas, nous affermissons la Loi » (Rom., III, 28-30).
La loi mosaïque s’inscrit dans un dessein plus vaste qui va d’Abraham à Jésus, de la promesse messianique à son accomplissement, et du vieil Adam au nouveau. C’est dans une visée universaliste qu’il faut comprendre les idées pauliniennes de rédemption et de justification par la foi. À la thèse rabbinique de la résurrection des justes, Paul oppose la thèse de la résurrection universelle. Il emprunte aux païens l’idée de « mystère » (le mystère du Christ) pour donner une interprétation spirituelle du messie souffrant (Isaïe) et de la nouvelle Alliance.
7. Croyance et confiance
Au terme de notre étude rétrospective sur l’histoire du vocabulaire, nous pouvons procéder à une analyse des concepts. Nous avons constaté que « foi » et « croyance religieuse » ne sont pas synonymes. Il convient de revenir sur ce point. L’ambiguïté vient de ce que le verbe « croire » peut s’employer dans deux sens différents. Soit dans un sens déclaratif : « Je crois que..., je tiens pour vraie une certaine déclaration. » Soit dans un sens performatif : « Je vous crois, je crois en vous, je crois en Dieu. » Dans ce cas, la parole vaut acte ; elle nous engage dans un lien de confiance à l’égard d’une autre personne. On a là deux idées qui s’emmêlent souvent dans la psychologie courante mais qui sont logiquement distinctes : l’idée de croyance et l’idée de confiance. La croyance peut prendre des formes différentes (opinion, persuasion, idéologie, conviction, etc.). Elle a néanmoins deux caractéristiques générales. D’une part, elle comporte (d’une manière plus ou moins explicite) un jugement : croire, c’est tenir pour vraie une proposition. En cela, on peut se tromper : une croyance peut être vraie ou fausse. D’autre part, la croyance est un guide du comportement. Elle ne se traduit pas seulement dans ce que je dis, mais dans ce que je fais. Dans mon attitude s’opposent affirmation ou négation, acceptation ou refus. Une croyance est donc soumise à deux sortes de conditions : des conditions de vérité (l’opposition du vrai et du faux ne dépend pas de nous, mais de ce qui existe indépendamment de nous) ; des conditions d’acceptabilité (l’opposition du « oui » et du « non » dépend de nous).
La confiance, en revanche, est une relation. On a vu que cette relation peut s’orienter dans deux sens complémentaires, actif ou passif (avoir confiance, être fiable). Alors que la croyance est une affaire individuelle, un jugement personnel, la foi implique une reconnaissance réciproque entre les personnes, entre celui qui donne sa parole (ou inspire confiance) et celui qui la reçoit (ou fait confiance). On notera que le sens actif du mot « confiance » est du côté de celui qui « reçoit ». C’est par l’histoire des formes de reconnaissance entre les personnes que la foi se distingue de la croyance. À Rome comme dans la Bible hébraïque, on l’a dit, ce sont les normes de fiabilité, de loyauté, de fidélité qui apparaissent au premier plan. Un prophète est reconnu digne de foi en vertu non point de ses qualités individuelles seulement, mais de la mission qui lui a été confiée par Dieu ; cette mission est attestée par des signes surnaturels de la même manière qu’un mandataire doit présenter ses lettres de créance. Un Romain veut être reconnu en vertu de son statut d’homme libre et de citoyen, alors qu’un Grec veut être reconnu pour lui-même, ce qui ne lui réussit pas toujours. L’adhésion du chrétien à la Parole de Dieu a besoin d’être reconnue dans la communion de l’Église par le moyen des rites du baptême et de l’eucharistie. Il apparaît donc bien dans tous les cas que ce sont les formes sociales de la reconnaissance entre les hommes qui permettent d’analyser le genre de relation confiante exprimé par le mot « foi ».
8. L’intelligence de la foi
Le 16 avril 1905, le philosophe Édouard Leroy avait publié dans les Cahiers de la Quinzaine un article intitulé :« Qu’est-ce qu’un dogme ? » Cet article engendra des controverses qui jouèrent un rôle central au cours de la crise moderniste. En 1907, sous le titre « Dogme et critique », l’auteur publiait de nouveau cet article en le faisant suivre de ses réponses aux objections.Étant donné qu’on appelle « dogme » toute doctrine faisant partie du « dépôt de la foi », la question posée par Leroy avait une portée très générale : qu’est-ce qu’une proposition théologique ? « Nous ne sommes plus au temps des hérésies partielles », écrivait-il ; il ne s’agit pas de savoir si tel ou tel dogme nous paraît acceptable ; il s’agit de savoir si les énoncés théologiques ont « un sens pensable », un contenu compréhensible. En les acceptant ou en les rejetant, pouvons-nous savoir ce que nous approuvons ou désapprouvons ? De quoi sont faits les jeux de langage que nous propose la religion ? La difficulté ne vient pas seulement du fait qu’ils utilisent souvent un vocabulaire désuet (celui des métaphysiques médiévales par exemple) ou des métaphores et autres formules allusives. Elle vient aussi de ce que les formulations religieuses tiennent un double langage déclaratif et normatif, mêlant de façon inextricable critères de vérité et légitimation d’une autorité, à mi-chemin entre la science et le droit, comme si l’on pouvait du même mouvement se prononcer sur ce qui existe en invoquant ce qui doit être. Les Anciens étaient moins sensibles que nous à ces façons de parler hybrides où l’on demande à l’existence de se conformer à l’idée plutôt que l’inverse. Dans la Bible, dans le Coran, dans n’importe quelle écriture sacrée, le vocabulaire de la religion apparaît partout multifonctionnel. En outre, la science des Anciens était totalisante ; elle prétendait expliquer globalement ce qu’elle était incapable de décrire analytiquement. Dans nos contrées, ce n’est guère qu’à partir du XVIIIe siècle que la littérature prit en charge l’une des fonctions de la religion, à savoir la connaissance du cœur humain, en même temps que l’universalité de la connaissance devenait la tâche infinie de la recherche scientifique.
En s’interrogeant sur le sens des énoncés théologiques, Édouard Leroy cherchait à concilier sa foi chrétienne avec l’honnêteté intellectuelle que requièrent les sciences de la nature et de l’histoire. Sa réponse était que les propositions théologiques ont une finalité pratique et ne doivent pas être traitées comme des énoncés scientifiques, au sens moderne du mot. Elles proposent à l’existence humaine une fin suprême. Mais celle-ci n’est pas donnée de l’extérieur comme un destin, elle est intérieure au devenir de la vie, elle se réfléchit dans une histoire en train de se faire.En effet, l’intelligence de la foi s’appuie sur une seule analogie fondamentale : le rapport de la créature à son créateur est analogue au rapport des hommes entre eux. Parler des êtres, c’est parler de leurs relations.Interpréter une proposition théologique consiste à établir une équivalence, au moins partielle, entre une phrase à l’indicatif et un ensemble de phrases à l’impératif. L’auteur expliquait ainsi que « la proposition „Dieu est un être personnel“ veut dire „comportez-vous dans vos relations avec Dieu comme dans vos relations avec une personne humaine“. Pareillement, „Jésus est ressuscité“ veut dire „soyez par rapport à lui comme vous auriez été avant sa mort, comme vous êtes vis-à-vis d’un contemporain“. De même, le dogme de la présence réelle veut dire qu’il faut avoir en face de l’hostie consacrée une attitude identique à celle qu’on aurait en face de Jésus devenu visible. Et ainsi de suite » (Dogme et critique). La répétition insistante des mots « veut dire » montre bien l’intention de l’auteur : il s’agit d’expliquer ce que le verbe « croire » veut dire. Cette intention ne fut pas bien comprise. Elle heurtait l’attitude naïvement apologétique de nombreux théologiens, habitués à plaider en faveur de « la vérité » d’une proposition. Mais, avant de savoir si une affirmation est vraie ou fausse, il faut s’entendre sur ce qu’elle veut dire. La méthode que proposait Leroy était de traiter les propositions théologiques non comme des proposition indépendantes mais comme des propositions complétives directes d’un verbe principal sous-entendu, le verbe croire, exactement comme dans le chant du Credo chaque article de foi est précédé du verbe principal : Credo in unum Deum, etc. En empruntant la terminologie de la philosophie analytique, nous dirions que Leroy interprétait la proposition théologique sur un mode pragmatique. Effectivement, de nombreux théologiens reprochèrent à Leroy son « pragmatisme ». Il y avait là une énorme équivoque, entretenue jusqu’à aujourd’hui par la célébrité de William James.Dans son livre sur Les Variétés de l’expérience religieuse, James voyait dans le pragmatisme une théorie de la vérité : est vrai, ce qui réussit. Cette formule est un sophisme (dit sophisme du modus ponens) qui suppose à tort que la vérité de la conclusion garantit la vérité des prémisses. Ce sophisme est un suicide intellectuel : en renonçant à chercher la raison de ce qui se produit, on abdique toute rationalité.Or le texte de Leroy cité plus haut montre qu’il se réfère à une tout autre conception, qui voit dans le mode pragmatique une théorie de la signification : « avoir un sens » porte à conséquence. Dans le domaine scientifique, on raisonne sur le mode pragmatique lorsqu’on s’interroge sur la signification ou la portée d’une hypothèse. Il s’agit alors d’explorer les conséquences de cette hypothèse pour savoir où elle mène. On suppose le problème résolu pour mieux analyser à quelles conditions il pourrait l’être.
Dans le domaine religieux, Leroy définit l’intelligence de la foi sur un mode exploratoire. Il explore la portée d’une affirmation religieuse en explicitant autant que possible ses conséquences pratiques, il explore la façon dont le rapport à Dieu se réfléchit dans le rapport entre les hommes. Toute affirmation religieuse pose deux sortes de problèmes : un problème de crédibilité et un problème de signification. Ces deux problèmes sont logiquement distincts, bien qu’ils réagissent psychologiquement l’un sur l’autre. La résurrection du Christ pose un problème de crédibilité qui relève de la critique historique des témoignages. Mais l’intelligence de la foi pose un problème de signification qui engage de multiples conséquences : croire à la résurrection veut dire « être réceptif à la révélation de Dieu dans la totalité de l’Évangile ». L’historien des religions sait que le point de vue du croyant doit être compris de l’intérieur, il accepte de se placer à ce point de vue comme on accepte une hypothèse indispensable à l’exégèse des textes et documents historiques. Dans ces conditions, l’historien et le croyant peuvent s’accorder sur l’idée qu’une religion forme un tout dans lequel les doctrines, les pratiques rituelles ou autres, et l’institution sociale doivent être analysées dans leurs relations mutuelles. Reste que l’historien a une tâche principalement rétrospective alors que celle du croyant est principalement prospective. L’esprit scientifique exige la bonne foi du chercheur mais, pour concilier la raison et la foi, le chrétien doit accorder entre elles la religion et la morale, ce qui n’est jamais acquis une fois pour toutes.