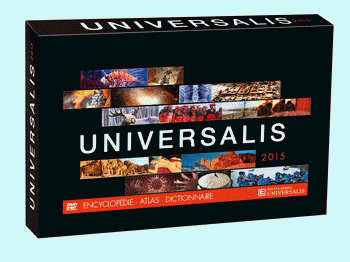BIBLE - L’inspiration biblique
Prise de vue
Le mot « inspiration » est fondamental dans le vocabulaire chrétien. Par le canal de la Vulgate, il vient directement de l’adjectif latin inspiratus. En II Timothée (III, 16), saint Paul affirme en effet que « toute l’Écriture » est « inspirée de Dieu » (en grec : théopneustos ; en latin : divinus inspiratus). Et pour la IIe épitre de Pierre (I, 21), les prophètes sont « portés par l’Esprit-Saint » (en grec : phéroménoi ; en latin : inspirati). C’est dans ces formules que la doctrine chrétienne de l’inspiration des Écritures trouva son expression précoce. Elle y est à la fois le point de convergence de courants antiques, grecs surtout, et le point de départ d’un développement doctrinal ininterrompu. Quant au sens dit propre que le mot « inspiration » a aujourd’hui, celui de respiration pulmonaire, il n’apparut qu’au XVIe siècle, avec Ambroise Paré.
1. Les sources de la doctrine de l’inspiration
Dans le monde antique, oriental et grec, on croyait volontiers que des révélations divines étaient transmises aux hommes par des personnages inspirés. L’enracinement culturel le plus ancien de la doctrine, juive puis spécifiquement chrétienne, de l’Écriture, est à chercher dans cette Antiquité lointaine.
L’Égypte ancienne, déjà, attribuait ses « saintes écritures » au dieu écrivain ou scribe Thot, le précurseur d’Hermès. Proche de cette figure égyptienne, il y avait aussi, et surtout, le dieu babylonien Nabû, fils de Marduk : considéré comme le scribe par excellence, on l’appelait le « scribe des dieux », le « scribe sans pareil », le « scribe de tout ce qui a un nom », le « scribe du sanctuaire mondial » (Esagil) d’où émanaient les lois divines : créateur de l’écriture, on le présentait comme le « seigneur du calame ».
Mais c’est en Grèce que l’idée d’inspiration trouva son terrain d’élection. L’Odyssée débute par cette invocation : « Muse, dis-moi [...], déesse née de Zeus, conte ces aventures. Et l’Iliade commence ainsi : « Chante la colère, déesse du fils de Pélée. » Chez Platon, le concept d’inspiration reçut un éclairage ample et précis, sous les deux aspects de « possession » et de « souffle divin ». Ainsi, Ion est déclaré bon rhapsode parce qu’une puissance divine (théia dunamis) le « meut ». Quant aux bons poètes, ils se distinguent réellement des mauvais « parce qu’un dieu est en eux et qu’il les possède » (enthéoi [...] kai katéchoménoi) ; un dieu dont la personnalité se substitue à la leur. Bien plus, le vrai poète doit être « inspiré » en recevant un « don divin par le moyen d’un délire » (dia manias) : il s’agit d’une réelle « possession » (katokochè) provenant des Muses (Phèdre). Les hommes politiques sont eux-mêmes inspirés, au même titre que les poètes (Ménon). La « possession » divine est donc le critère unique d’authenticité des activités et des fonctions qui, dans la cité, se particularisent par la créativité.
Le vocabulaire et les idées de Platon sur l’inspiration ont fortement marqué le grand commentateur juif de la Torah, Philon d’Alexandrie. Pour celui-ci, les « livres saints », qui ne sauraient être d’aucune façon des « témoins douteux », sont l’expression du « saint Logos ». D’où les vertus du « prophète » qui les publie, selon les deux textes suivants :
– « Car le prophète ne publie absolument rien de son cru, mais il est l’interprète (herméneus) d’un autre personnage, qui lui souffle toutes les paroles qu’il articule au moment même où l’inspiration (enthousia) le saisit et où il perd la conscience de lui-même, du fait que [...] l’Esprit divin visite et habite la citadelle de l’âme et qu’il fait retentir et résonner de l’intérieur toute l’instrumentation vocale pour manifester clairement ce qu’il prédit » (De specialibus legibus, IV, 49).
– « Cela arrive à la race prophétique : l’intellect (nous), en nous, est chassé au moment où arrive le souffle divin ; car il n’est pas permis que le mortel cohabite avec l’immortel. C’est la raison pour laquelle le coucher du raisonnement [...] engendre l’extase et le délire venu de Dieu » (Quis rerum divinarum heres sit, 225).
Pour Philon, la vertu de l’inspiration est également le lot des traducteurs de la
Bible dite des Septante, lesquels, affirme-t-il, « prophétisèrent comme si Dieu avait pris possession de leur esprit [...] chacun sous la dictée d’un invisible souffleur » (De vita Mosis II, 37). Et notre auteur d’aller plus loin, déclarant que l’interprète véritable des Écritures, c’est-à-dire le commentateur allégorique, lui-même en l’occurrence, est également « inspiré » tout comme les prophètes, dont le modèle est Moïse et à la lignée desquels il appartient.
L’idée grecque de possession se retrouve chez d’autres témoins du judaïsme de langue grecque, ainsi le livre III des Oracles sybillins. Quant à Flavius Josèphe, grand praticien des Écritures juives, il est paradoxalement avare de mots et de discours s’agissant de l’inspiration. Il rompt cependant une fois son silence, d’une façon intéressante. À la suite des auteurs grecs de l’âge classique, Platon et Aristote par exemple, il emploie le vieux vocable non biblique épipnoia, « souffle », dérivé du verbe pnein, « souffler », et ce, justement, à propos des « écrits » sacrés (Contre Apion I, 37).
L’influence gréco-orientale s’est exercée aussi dans un secteur du judaïsme ancien n’appartenant pas directement à l’aire hellénistique, celui des apocalypses, probablement palestiniennes, contemporaines des débuts du christianisme. Il faut ici mentionner le IVe livre d’Esdras, dont le chapitre XIV contient un étonnant passage. Avant de rédiger son œuvre, c’est-à-dire de réécrire la Torah, censée détruite lors de l’incendie du temple de Jérusalem, en 587 av. J.-C., Esdras demande l’inspiration de l’Esprit-Saint. Une voix lui enjoint alors de boire à une coupe « apparemment remplie d’eau à couleur de feu ». Il boit, et « son cœur faisait sourdre l’intelligence » ; sa « bouche soufflait la science ». C’est là un bel exemple de traitement en quelque sorte rationnel, quoique par la voie mythique et sous l’influence de pratiques typiquement grecques, des idées juives déjà traditionnelles sur l’inspiration des Écritures. La présence du vin dans le corps signifiait la présence de Dionysos en personne. La prêtresse de Delphes, on le sait, devait boire le lalon hudor, l’« eau qui fait parler », à la source sacrée, proche du temple.
Les fraternités de Qumran avaient elles-mêmes élaboré une vraie doctrine de l’inspiration des Écritures. À la différence des rabbins à venir, dans le judaïsme dit rabbinique, mais dans la bonne ligne de Philon et du IVe livre d’Esdras, et du christianisme, les maîtres des bords de la mer Morte homologuaient les textes des prophètes comme Torah à part entière. Pour eux, toute la Torah était « inspirée », destinée à être interprétée par des personnalités « illuminées » par l’Esprit-Saint ou prophétiques, elles-mêmes dès lors inspirées.
Ainsi peuvent être désignées les sources majeures de la doctrine chrétienne de l’inspiration des Écritures. Cette doctrine suppose, en son amont, l’existence d’un corpus plus ou moins officiel ou institué, appelé Torah, ou nomos chez les juifs. Son objet est néanmoins plus large, comprenant volontiers l’œuvre de traduction, voire d’interprétation. Le christianisme s’emploiera à resserrer les limites de l’objet de l’inspiration pour les faire coïncider une fois pour toutes et exclusivement avec celles du canon des Écritures ; mais ce ne sera que progressivement, la constitution du canon du Nouveau Testament et, partant, la définition quantitative du canon chrétien ayant demandé des siècles.
2. Les Pères de l’Église : artisans et témoins de la doctrine chrétienne de l’inspiration
À la fin du Ier siècle de l’ère chrétienne, donc, dans la fameuse épître aux Corinthiens, que la tradition la plus ancienne lui attribue, Clément de Rome écrit : « Vous vous êtes plongés dans les saintes Écritures, ces vraies Écritures données par l’Esprit-Saint. » Il désigne les prophètes bibliques comme les « ministres de la grâce de Dieu, mus par l’Esprit-Saint ». À sa suite, Justin, Irénée, Hippolyte de Rome, Origène, Jérôme, et bien d’autres, en Orient comme en Occident, utilisent le mot « inspiration » (épipnoia, assez souvent, chez les auteurs grecs) en l’appliquant encore parfois à un champ littéraire ou discursif débordant assez largement celui des Écritures sacrées dans leurs limites strictes. Ainsi, Clément de Rome, désireux de fonder l’autorité voire l’universalité de ses arguments, semble se placer lui-même parmi les auteurs inspirés quand il écrit : « Vous nous procurez joie et allégresse si vous obéissez à ce que nous avons écrit par le Saint-Esprit. » Pour Origène, l’inspiration divine (théou épipnoia) est nécessaire aussi au philosophe pour que puisse lui être « manifestée la nature du mal, révélé son mode d’apparition, comprise la façon dont il disparaîtra » (Contre Celse, IV, 65). Grégoire de Nazianze n’hésite pas à présenter les homélies de saint Basile comme divinement inspirées, ni saint Augustin à affirmer que Jérôme a écrit sous la « dictée » de l’Esprit. Pourquoi cet élargissement ? Philon d’Alexandrie, l’une des sources importantes des Pères, présentait volontiers sa propre interprétation des Écritures comme inspirée par l’Esprit-Saint. Ce précédent juif a dû influer sur la réflexion chrétienne des premiers siècles. Il y a autre chose. Les textes attribués aux Apôtres, non encore placés, en tout ou en partie, sous l’appellation de Nouveau Testament, se présentaient pour une bonne part comme l’interprétation et l’achèvement des Écritures déjà bien instituées. De cette prérogative elles tenaient d’autant plus leur autorité que les paroles de Jésus-Christ dont elles témoignaient, et qu’elles prolongeaient, les avaient précédées sur cette voie. Dans cette logique, les écrits des Pères anciens pouvaient comme naturellement revendiquer d’intervenir eux-mêmes dans le sillage direct des Apôtres. Il faut évoquer enfin la façon dont s’est posée chez les Pères, à partir du IIIe siècle et même déjà du IIe, la question du rapport entre la Tradition et l’Écriture : il fallut du temps pour préciser ces deux concepts et pour asseoir l’autorité de ce que chacun d’eux désigne ; on ne put donc éviter des ambiguïtés transitoires.
De la conception des Écritures comme divinement inspirées, les Pères sont passés, quoique tardivement, à celle de Dieu comme leur auteur véritable. Les controverses qui opposèrent l’Église d’Afrique et les manichéens aux IVe et Ve siècles acclimatèrent le terme d’« auteur » dans le vocabulaire des déclarations ecclésiastiques et lui donnèrent son sens littéraire en spécifiant la notion grecque de cause. Saint Ambroise déjà, dans la seconde partie du IVe siècle, tient les mots de l’Écriture pour ceux de Dieu et non ceux des hommes. On approche de la formule définitive, venue formellement sous la plume de Grégoire le Grand (590-604) : « Par la foi, écrit celui-ci, nous croyons que l’auteur du livre est l’Esprit-Saint. C’est donc lui-même qui l’a écrit, lui qui l’a dicté : il l’a écrit lui-même, lui qui a été l’inspirateur de l’œuvre » (Moralia, Préface I, 2). Cette idée fera son chemin ; c’est sur elle que l’on fondera surtout la doctrine ecclésiastique de l’« inerrance » des Écritures inspirées.
Les Pères sont allés plus loin encore sur la voie qui faisait de Dieu l’auteur des Écritures inspirées. Ils n’ont pas hésité à comparer l’Écriture à une lettre venue de la patrie du Père céleste, notre vraie patrie : c’est le cas de Jean Chrysostome, Augustin et Grégoire le Grand. Augustin fait de l’Écriture le « chirographe [scribe] de Dieu » et le « stylet du Saint-Esprit » (Confessions XII, 367). C’est ici qu’il faut mentionner l’image de la dictée. Les Pères ont en effet parfois substitué le verbe « dicter » (en grec : hupagoreuein ; en latin : dictare) au verbe « inspirer ». Les auteurs scolastiques les ont suivis, ainsi que les documents ecclésiastiques postérieurs.
Or, les Pères n’oubliaient pas pour autant qu’il y avait bien eu des auteurs ou des écrivains, en chair et en os, désignés comme « sacrés ». Dès lors la fonction de ces agents, humains mais revêtus d’une vertu identifiée comme divine, devait-elle être précisée. C’est ici qu’intervint la représentation de l’auteur comme « instrument » de Dieu, implicitement contenue dans la représentation de Dieu comme auteur des Écritures. L’image augustinienne du chirographe divin ou du stylet initiait de soi celle de l’instrument, du moins dans la tradition latine. Clément d’Alexandrie, déjà, présentait en effet les prophètes comme les « instruments de la langue divine » (Stromates, VI, 18). Telle quelle, avec des variantes, l’image instrumentale, déjà repérée chez Philon, a inlassablement cheminé, des Pères de l’Église aux grands représentants de la scolastique, et jusqu’aux encycliques bibliques de Léon XIII, de Benoît XV et de Pie XII.
Par Écritures, « saintes » ou « sacrées », ils entendaient bien sûr l’Ancien Testament, au moins l’ensemble consensuel de celui-ci. Mais ils affirmèrent aussi, précocement, l’inspiration divine du Nouveau Testament, du moins en certaines de ses sections. Au fur et à mesure que se constitua un canon, qui prendra le nom de Novum Testamentum, et ce, en tant que distinct et complémentaire de Vetus Testamentum, le champ propre et délimité de l’inspiration scripturaire s’élargit. Les Écritures, c’est-à-dire l’Ancien et le Nouveau Testament, sont inspirées par l’Esprit-Saint, ce qui implique qu’elles ont Dieu pour auteur véritable et que, partant, elles sont parole de Dieu à l’adresse du peuple chrétien réuni dans l’Église. Dès lors, tout ce que l’Écriture sollicitait de réflexions et d’approfondissements, de définitions et de discours s’agissant de son origine et de sa nature, de sa constitution et de sa fonction, autrement dit de tout ce qui n’était pas elle mais qui la concernait ou qu’elle concernait, se trouvait de quelque façon énoncé.
3. Le magistère ecclésiastique : élaboration dogmatique de la doctrine de l’inspiration
Collection de décisions énoncées par divers conciles, de Provence principalement, compilées durant la seconde moitié du Ve siècle, les Statuta Ecclesiae antiqua prononcent la doctrine de l’origine et dès lors de la nature divine des écrits sacrés. On se référa textuellement à ce document normatif jusqu’à la fin du Moyen Âge. Les termes en ont été repris, sensiblement explicités, en 1442, dans le décret pour les jacobites du concile de Florence, suivis de la liste des livres des deux Testaments et d’une condamnation des manichéens.
Le concile de Trente élabora et promulgua un très important document, le décret sur la réception des livres sacrés et des traditions, en 1546, l’année de la mort de Luther. On y traite de l’origine et de la nature, du statut et de la fonction des Écritures saintes, en tant que telles et dans l’Église. Le but premier était certes de définir solidement la foi catholique face aux ruptures de la Réforme. Il fallait aussi riposter aux questions graves que posaient déjà à la cohérence du catholicisme romain les travaux philologiques que juifs et chrétiens menaient, depuis un siècle environ, sur les langues bibliques, l’hébreu en particulier. Il y avait, de plus, les doutes que certains humanistes chrétiens contemporains émettaient quant au caractère de totalité dont la doctrine ecclésiastique revêtait l’inspiration. Le décret donne aussi la liste des livres constituant le canon des Écritures, laquelle ne sera jamais plus revue ni rectifiée dans le catholicisme romain.
Pour la première fois dans l’histoire des définitions dogmatiques, le concile de Trente affirmait nettement que « toute vérité salutaire et toute règle morale » sont contenues et « dans les livres écrits et dans les traditions non écrites », le verbe « dicter » et l’action de l’Esprit-Saint s’appliquant à celles-ci tout comme à ceux-là. Le mot inspiration n’est pas énoncé, mais le fait en est solidement fondé.
La définition formelle, précise et solennelle, de l’inspiration des Écritures ne fut donnée dans l’Église catholique qu’avec la constitution dogmatique Dei Filius du concile Vatican I, en 1870. L’inspiration des écritures par l’Esprit-Saint est ici nettement définie, Dieu étant présenté comme l’auteur des textes sacrés. Nouvelles par rapport au concile de Trente dont elles homologuèrent cependant l’essentiel des termes, les déclarations de Vatican II s’expliquent par la nécessité pour l’Église de se situer face aux idées dites des Lumières, avec surtout les apports de la philologie et de l’histoire au service de la critique dans le champ des études bibliques. La foi chrétienne n’était plus l’élément moteur de la société ni, au sein de celle-ci, de la culture. Un siècle d’histoire et d’expériences avait fait la démonstration de l’irréversibilité de la situation. Dans un tel contexte, tout ce qui était sacré, et la
Bible au premier chef, devait se situer, se définir et se déterminer dans un espace et selon un rapport de partenariat fécond avec ce qui ne l’était pas. On ne pouvait donc éviter non seulement de rappeler mais aussi de rigoureusement formuler la doctrine séculaire relative au caractère exhaustivement divin des Écritures, ce qui entraînait obligatoirement l’accentuation, sur le mode dogmatique le plus fort, de la croyance unanime des chrétiens à l’inspiration des textes sacrés.
Le pape Léon XIII traita solennellement du problème scripturaire global dans sa grande encyclique sur la
Bible et les études bibliques, Providentissimus (18 novembre 1893). Ce document manifestait une ouverture résolue à la recherche contemporaine. Il fallait situer la valeur de message biblique par rapport aux conceptions nouvelles que la science imposait. Pour la première fois, la question de la vérité totale des Écritures allait se trouver posée ; vérité qui n’est que l’autre face du fait dogmatique indiscutable de l’inspiration scripturaire.
Léon XIII ira jusqu’à déclarer que les écrivains sacrés, ce qui veut dire Dieu comme auteur des Écritures, n’ont pas voulu enseigner aux hommes la « situation interne des réalités sensibles », autrement dit les choses « sans utilité pour leur salut ». Sans employer la formule « genres littéraires », qui n’interviendra qu’un demi-siècle plus tard dans les documents ecclésiastiques officiels, il se montre néanmoins précurseur en la matière quand il écrit : « Plutôt que de poursuivre une investigation en règle de la nature, [les auteurs inspirés] décrivaient et traitaient des choses occasionnellement, soit en style figuratif, soit selon la manière de parler courante en leur temps. »
L’encyclique Providentissimus, s’agissant des saintes Écritures, était tout aussi novatrice que l’encyclique Rerum novarum du même pape, s’agissant de la doctrine sociale de l’Église. Les choses de Dieu et les choses du monde étaient bien distinctes, situées respectivement dans leur ordre propre ; et leur relation pouvait dès lors résolument s’établir. Il était possible d’affirmer, à la suite des Pères de l’Église et de leur postérité ecclésiastique, que la
Bible était œuvre et parole divines, et d’admettre en même temps qu’elle était aussi, conjointement, vrai langage d’homme. Léon XIII a osé déclarer que la
Bible ne proposait aucune leçon d’histoire naturelle, son enseignement concernant essentiellement les réalités ou moyens destinés au salut des hommes. La question de la vérité des Écritures inspirées se trouvait donc, compte tenu de l’époque et du contexte, adéquatement posée. Les savants n’étaient plus les ennemis ni de la
Bible ni de la Révélation. On respectait les frontières de leur savoir, au nom même de l’énoncé de la foi, dont ils étaient eux-mêmes conviés à respecter les frontières. Ainsi commençait à s’instaurer, par la médiation de l’Écriture et de la doctrine la concernant, le statut de l’Église et de la foi à l’ère scientifique.
La plupart des successeurs de Léon XIII sur le siège apostolique s’employèrent à faire écho, soit partiellement, soit très largement, aux déclarations officielles de 1893. L’enjeu était grave : toucher à l’origine divine de la
Bible inspirée, c’était toucher à la Révélation, c’est-à-dire au fondement même de la foi chrétienne. Ainsi, tout ce qui avait été défini par l’Église relativement à l’inspiration, au caractère propre et à l’étude des Écritures se trouva repris formellement dans les condamnations circonstanciées des propositions des modernistes dans le décret Lamentabili du Saint-Office promulgué sous Pie X, le 3 juillet 1907.
Pour sa part, Benoît XV profita du quinzième centenaire de la mort de saint Jérôme pour reprendre et souligner encore davantage, dans l’encyclique Spiritus Paraclitus du 15 septembre 1920, la doctrine de l’inspiration proclamée par Léon XIII. Il faut noter un point nouveau, du moins dans ce qu’il a d’explicite : la libre coopération de l’écrivain sacré « avec l’inspiration de Dieu ». Léon XIII, avec sa notion d’« auteur principal » attribuée au principe divin et, corrélativement, avec la systématisation de l’image de l’« instrument » imputée à l’écrivain sacré, présenté comme « assisté » en tous ses gestes, risquait, en dépit de l’attention portée à la « manière de parler courante » des contemporains, de compromettre ou au moins de voiler les bases nécessaires d’un partenariat véritable entre la source et la force inspiratrices, d’un côté, et le savoir-faire humain, de l’autre.
Pie XII célébra le cinquantième anniversaire de Providentissimus par la promulgation de sa propre encyclique sur la
Bible et les études bibliques, Divino afflante Spiritu, du 30 septembre 1943. Ce document présente quelque chose de définitif, dans la façon surtout dont il a résolument posé tous problèmes dont la pression culturelle du monde contemporain, y compris par le canal de la critique biblique scientifiquement insistante jusque chez les catholiques, sollicitait plus ou moins implicitement l’examen. Pie XII va plus loin encore que ses prédécesseurs. Il demande aux exégètes – ce mot, qui suppose la démarche savante, a largement droit de cité chez lui – de discerner « quels genres littéraires les auteurs de cet âge antique ont voulu employer ». Une telle tâche exige le recours à la critique, avec le concours « des ressources de l’histoire, de l’archéologie, de l’ethnologie et des autres sciences ». La quête du « sens littéral » est l’un des objectifs de ces recherches, qui supposent l’établissement du texte dit original et primitif, et, partant, l’étude des langues anciennes dites bibliques, l’hébreu, l’araméen et le grec. Ainsi, les deux faces constitutives du fait scripturaire considéré à sa source, la face divine et la face humaine, sont prises résolument en considération.
Le 7 décembre 1965 fut promulguée à Rome la constitution dogmatique sur la révélation divine du concile Vatican II, Dei Verbum. Ce document se situait dans le sillage fidèle des déclarations antérieures, avec cependant une note propre et des ouvertures que l’attention pastorale au contexte culturel et religieux de l’époque, dans sa dimension œcuménique surtout, appelaient vivement. S’agissant de l’inspiration, il homologuait nettement les avancées de Pie XII quant à la prise en compe de l’acte autonome de l’auteur. Il est significatif qu’il omet la formule « auteur principal » de Léon XIII et déclare que les « auteurs inspirés » sont de « vrais auteurs » (veri auctores). C’est dans ce cadre qu’il posa et résolut aussi la grave question de la vérité des Écritures ; question que l’on peut formuler ainsi : comment préserver à l’Écriture son privilège d’être sans erreur que le fait de l’inspiration induit comme sa conséquence première, tout en l’ouvrant à l’homme, autrement dit à tout homme possible et culturellement toujours différent, que l’on regarde celui-ci du côté de l’auteur ou du côté du lecteur ? Pour Vatican II, qui évite le mot trop négatif d’« inerrance » que les théologiens avaient forgé et parle de « vérité pour notre salut », c’est la force et l’authenticité du lien entre l’Écriture, canon institué, et l’Église, qui peuvent seules assurer la pérennité de ladite vérité.
La revue des déclarations officielles de l’Église sur l’inspiration biblique nous a renvoyé à chaque fois au contexte culturel, sinon politique, qui avait commandé l’intervention du magistère ecclésiastique. C’est dans cet affrontement avec l’histoire que l’Église est parvenue pour une large part à définir l’objet et la nature ainsi que les raisons et le but ultimes de l’inspiration des Écritures. L’histoire dogmatique de l’inspiration suit à sa façon l’histoire éthique de l’inlassable montée de la conscience humaine. L’avènement de celle-ci dans sa liberté individuelle coïncide avec la reconnaissance de l’auteur sacré dans l’autonomie de tous ses moyens raisonnables. De ce point de vue, la définition de l’inspiration à l’ère scientifique, au terme d’un long processus de maturation qui mit en place le partenariat nécessaire entre ce qui est divin et ce qui est humain, contribua, pour sa part et à sa manière, à l’élaboration de la grande leçon sur l’homme qui a toujours été l’un des objectifs majeurs du christianisme.