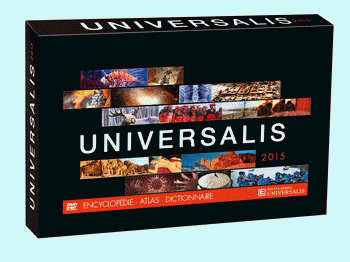THÉOSOPHIE
Prise de vue
Au sens restreint, le mot « ésotérisme » désigne une gnose procurant l’illumination et le salut individuels grâce à la connaissance des rapports qui unissent l’homme aux esprits intermédiaires ou divins. La théosophie, elle, concerne d’abord la connaissance des mystères cachés de la divinité et, par extension, celle de l’univers dans ses rapports avec Dieu et avec les hommes. C’est pourquoi on peut parler d’ésotérisme au sens large lorsque celui-ci s’enrichit de la dimension théosophique.
1. Théosophie et ésotérisme : histoire d’un mot
Le mot theosophia, qui signifie étymologiquement « sagesse de Dieu », apparaît chez plusieurs Pères de l’Église, grecs et latins, comme synonyme de « théologie » ; et cela tout naturellement, puisque sophia signifie à la fois une connaissance, une doctrine et une sagesse. Le sophos est un « sage ». Les theosophoï sont, littéralement, « ceux qui connaissent les choses divines ». Mais si l’on relevait tous les emplois de ce mot chez les auteurs religieux depuis le début du christianisme jusqu’à la Renaissance, on verrait qu’il s’écarte parfois du sens de son synonyme theologia, de la théologie telle que nous l’entendons encore aujourd’hui. Il suggère plus ou moins, en effet, l’existence d’une connaissance de type gnostique (à la manière non du gnosticisme des premiers siècles, mais de l’attitude d’esprit spécifiquement ésotérique). C’est dans ce sens, par exemple, que tendent à l’employer le Pseudo-Denys, au VIe siècle, et, d’une manière moins nette, au XIIIe, l’auteur de l’étonnante Summa philosophiae, qui n’est sans doute pas Robert Grosseteste auquel on l’a jadis attribuée, mais qui provient du même milieu que le sien. Cet auteur distingue les « philosophes » (Platon, Aristote, Averroès, notamment), les « modernes » (Alexandre de Hales, Albert de Cologne), les « théosophes » (c’est-à-dire tous les auteurs inspirés par les livres saints) et les « théologiens », ceux qui ont pour tâche d’expliquer la théosophie (le Pseudo-Denys, Ambroise, Jérôme, Augustin, Origène, par exemple). Chez d’autres, les contours de ce concept sont aussi flottants. Il semble qu’il faille attendre la Renaissance pour rencontrer plus souvent ce mot, mais il est encore plus ou moins synonyme de « théologie » ou de philosophie. Johannes Reuchlin qui, au début du XVIe siècle, contribue grandement à répandre la Kabbale chrétienne, parle des theosophistae pour désigner les scolastiques décadents, suivi en cela par Cornelius Agrippa. Du Cange nous renseigne sur cet emploi, à l’époque, de theosophia pour theologia (cf. son Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, 1733-1736). De 1540 à 1553, Johannes Arboreus (Alabri) publie une Theosophia en plusieurs volumes, mais il ne s’agit guère d’ésotérisme.
Le sens du mot se précise nettement au début du XVIIe siècle, peut-être sous l’influence de l’Arbatel, livre de magie blanche paru vers 1550 ou 1560, et fort répandu, où ce terme a déjà son sens actuel. On le trouve dès lors chez des auteurs aussi importants que Heinrich Khunrath (De Igne), Oswald Croll (Basilica chymica) et surtout Jacob Boehme. À la fin du chapitre VIII du De signatura rerum (§ 56), répondant à ceux qui lui reprochent de confondre la Nature avec Dieu, donc d’être « païen », Boehme précise qu’il ne parle pas de la nature régie par le spiritus mundi, mais d’une autre nature, qui est Verbe (ou Mercure) intérieur ; et il écrit à ce propos : « Ich schreibe nicht Heidnisch, sondern Theosophisch » (« Je n’écris pas comme un païen, mais comme un théosophe »). La théosophie de Boehme comporte une philosophie de la Nature, mais il conçoit cette nature comme essentiellement céleste et divine ; de nombreux théosophes ultérieurs, même inspirés par lui, intégreront à cette philosophie la nature entière, sous toutes ses formes, même les plus concrètes. Exactement contemporain est aussi le titre sous lequel paraît, à Neustadt, en 1618 et pour la première fois, le livre de Valentin Weigel : Libellus theosophiae (Ein Büchlein der göttlichen Weisheit) – le titre n’est pas de l’auteur, mort trente ans plus tôt, mais il est contemporain de la publication. On voit, par ces exemples, que le sens du mot se précise au moment où la chose elle-même est en train de s’élaborer une fois pour toutes en Allemagne, chez plusieurs auteurs en même temps, avec la plupart des caractéristiques qu’elle conservera par la suite. Le moment où la théosophie acquiert ses lettres de noblesse coïncide en Allemagne avec l’apogée de la littérature baroque, à laquelle d’ailleurs les historiens des lettres la rattachent volontiers, ainsi qu’avec la naissance du mouvement dit Rose-Croix, c’est-à-dire aux alentours des années 1610-1620. Dès lors, on emploiera fréquemment le mot, tout au long du XVIIe siècle, comme le font, par exemple, ces deux théosophes que sont Johann Georg Gichtel et Gottfried Arnold. Il s’accompagnera d’ailleurs, à cette époque, d’un mot voisin, celui de « pansophie », très en vogue dans les milieux rosicruciens et paracelsiens. Il convient d’entendre, par « pansophie », comme l’a précisé W. F. Peuckert, une connaissance des choses divines acquise en partant du monde concret, c’est-à-dire de l’univers entier, dont il s’agit d’abord de déchiffrer les « signatures » ou hiéroglyphes. En d’autres termes, le Livre de la Nature nous aide à mieux comprendre l’Écriture et Dieu lui-même. On réserverait alors à la démarche inverse, qui consiste à connaître l’univers grâce à la connaissance qu’on a de Dieu, le terme de théosophie. Mais, pratiquement, et surtout à partir du XVIIIe siècle, c’est « théosophie » qu’on emploie généralement, pour nommer aussi bien la démarche pansophique.
Au XVIIIe siècle, le mot et le concept de « théosophie » entrent dans le vocabulaire philosophique et se répandent largement. Les deux plus importantes œuvres théosophiques du début du siècle sont allemandes, elles aussi ; leur retentissement sera grand, et leurs titres sont explicites : Theophilosophia theoretica et practica (1710), de Sincerus Renatus, et Opus mago-cabalisticum et theosophicum (1721), de Georg von Welling. C’est dans ce sens qu’à nouveau Franciscus Buddeus enregistre le mot dans son Isagoge (Leipzig, 1727) ; mais, surtout, le pasteur Jacob Brucker consacre à la théosophie un énorme chapitre (« De theosophiis ») de sa monumentale Historia critica philosophiae, publiée en latin à Leipzig en 1741. Tous les théosophes y sont présents. C’est une consécration officielle dans le monde des lettres, d’autant que Brucker va rester, durant tout le siècle des Lumières, la référence obligée en matière d’histoire de la philosophie. Peu d’auteurs, même parmi les ésotéristes eux-mêmes, auront contribué autant que lui à faire connaître la théosophie, dont lui-même pourtant ne se sentait guère proche !
Au demeurant, le mot est absent de la plupart des grands dictionnaires français de l’époque des Lumières. On ne le trouve ni chez Furetière, ni dans les éditions du Dictionnaire de l’Académie, ni dans le Dictionnaire de Bayle. Dans celui de Trévoux, il a droit à une courte mention, d’ailleurs incolore. Mais le temps perdu est rattrapé, grâce à Denis Diderot. Dans l’article « Théosophes » de sa grande Encyclopédie, article fort copieux dont il est lui-même l’auteur, il reprend des passages entiers de Brucker, sans citer sa source, en commettant quelques contresens que le fait de donner une traduction libre ne permet pas d’excuser tout à fait. Son français est beaucoup plus élégant et séduisant que le latin embarrassé de Brucker, mais le contenu est plus superficiel aussi. Au demeurant, Diderot hésite entre la sympathie et le dédain ; et, en tout cas, il n’a guère la tête théosophique, malgré une certaine attirance pour les représentants de ce courant. Néanmoins, bien que Diderot ait par son article consacré l’usage du mot en France, on a continué encore quelque temps à l’employer dans d’autres sens ; par exemple, Kant appelle « théosophisme » le système des philosophes qui, comme Malebranche, croient voir tout en Dieu. C’est pourtant, en littérature même, l’usage dorénavant normal et définitif qui prévaut ; ainsi, Friedrich Schiller intitule un de ses premiers textes « Theosophie des Julius » (dans sa revue Thalia, en 1787). Une certaine confusion apparaîtra à partir de 1875, quand Mme Blavatsky fondera la Société théosophique, car celle-ci se présente d’une manière différente ; malheureusement, c’est souvent à cette société que l’on pense aujourd’hui quand le mot « théosophie » est prononcé.
2. Herméneutique théosophique et discours mythique
Revenons à notre propos initial sur le sens du mot « théosophie » et sur la place de la théosophie dans ce qu’on appelle l’ésotérisme. Par « théosophie », de même que par « ésotérisme », on entend donc d’abord une herméneutique (ta’wil, en Iran), c’est-à-dire une interprétation de l’enseignement divin – par exemple, du Livre révélé – fondée à la fois sur une démarche intellectuelle, spéculative (le mode de pensée est ici analogique et homologique, l’homme et l’univers étant considérés comme les symboles de Dieu), et sur une révélation due à une illumination. Dans le cas de la théosophie, cette interprétation porte sur les mystères intérieurs à la divinité elle-même – c’est la théosophie au sens restreint – ou sur ceux-ci et l’univers entier – c’est la théosophie au sens large, celui dont il s’agit ici.
Le théosophe part toujours d’un donné révélé, celui de son mythe – par exemple, le récit de la Création au début de la Genèse –, dont il fait jaillir les résonances symboliques par son imagination active. Il pense ainsi pénétrer les mystères de l’univers et des rapports qui unissent celui-ci avec l’homme et avec le monde divin. Comme pour la gnose comprise comme voie de salut individuel, l’idée de « pénétration » théosophique renvoie à celle d’« intériorisme » ; néanmoins, il s’agit, cette fois, de descendre non plus seulement en soi, mais aussi dans la profondeur de Dieu et des choses naturelles, ces deux mouvements se complétant d’ailleurs. Dans ses profondeurs, la Déïté « repose en elle-même », enseigne Jacob Boehme, c’est-à-dire qu’elle demeure dans son absolue transcendance ; mais, en même temps, elle sort d’elle-même, car « Dieu est un trésor caché qui aspire à être connu ». Il se fait connaître en se dédoublant au sein d’une sphère ontologique située entre notre monde créé et l’inconnaissable, sphère qui sera le lieu de rencontre entre Dieu et la créature (mais, bien entendu, nous ne connaissons Dieu que pour autant qu’il se révèle à nous selon nos structures anthropologiques et culturelles). En même temps, les mondes viennent à l’Être, prennent forme, pour être le lieu de la manifestation divine.
Le théosophe recherche, derrière le foisonnement du réel, le sens caché des chiffres ou hiéroglyphes de la nature ; cette quête reste nécessairement inséparable d’une plongée intuitive dans le mythe auquel il adhère par sa foi et son imagination active. Tantôt il part d’une réflexion sur les choses pour comprendre Dieu – c’est l’attitude appelée parfois pansophique –, tantôt il s’efforce de saisir le devenir du monde divin – sa question n’est pas an sit Deus ?, mais quid sit Deus ? –, pour comprendre le monde du même coup et posséder ainsi la vision intime du principe de la réalité de l’univers et de son devenir. Les aspects du mythe sur lesquels il met tout naturellement l’accent se trouvent être ceux que les Églises constituées ont tendance à négliger ou à passer sous silence : nature de la chute de Lucifer et de celle d’Adam, androgynéité de celui-ci, sophiologie, arithmosophie, etc. Le théosophe croit en une révélation permanente dont lui-même est l’objet, et son discours donne toujours l’impression qu’il reçoit la connaissance en même temps que l’inspiration. Il insère chaque observation concrète dans un système total, mais indéfiniment ouvert, qui repose toujours sur le triptyque de l’origine, de l’état présent et des choses finales ; c’est-à-dire sur une cosmogonie (liée à une théogonie et à une anthropogonie), une cosmologie et une eschatologie. Saint Paul semble avoir justifié par avance cette recherche active et opératoire, en écrivant que « l’Esprit scrute tout, jusqu’aux profondeurs divines ») (I Cor., II, 10). Mais, chez le théosophe, comme chez le gnostique en général, toute augmentation de savoir s’accompagne d’un changement de l’être, processus heureusement inévitable dès lors qu’il joue les drames théogoniques et cosmiques, qu’il mime les esprits et les éléments. Le discours qu’il profère, le récitatif qu’il module ne semblent pas être son œuvre propre, mais plutôt celle d’un ange dont il serait seulement l’organe ; aussi est-ce dans le choix de ses images et dans la forme de son discours qu’on peut découvrir chaque fois son originalité propre. Il ne s’agit pas tant pour lui d’inventer, d’être original, que de se souvenir, l’ignorance étant une conséquence de la chute. Le théosophe consacre son énergie à « inventer », mais au sens originel de « retrouver », l’articulation de toutes les choses visibles et invisibles, en scrutant à la fois le divin et la Nature, observée souvent dans ses plus infimes détails. Il est un herméneute inventeur d’une interprétation dont il nous invite à être les herméneutes. Son témoignage nous entraîne dans un ta’wil jamais fini, toujours ouvert.
À l’époque dite archaïque de la Grèce, le mythos et le logos – qui ensemble constituent la « mythologie » – ne s’opposent pas l’un l’autre ; ils évoquent un récit sacré concernant les dieux et les héros. Mais peu à peu le logos l’a emporté sur le mythos, la philosophie sur la mythologie, au détriment de la métonymie et des significatifs déplacements de sens. L’herméneutique contemporaine a retrouvé au moins la pluralité de sens, mais la démarche théosophique va plus loin ; par nature, elle évite les impasses, car, au lieu de la juxtaposition des traductions de sens, elle pratique la progression d’un discours qui ne prétend pas dire autre chose que lui-même. Le récit révélé sur lequel elle s’appuie doit être reconduit, revécu, sous peine de s’évaporer en concepts abstraits. Aussi la théosophie a-t-elle toujours, quoique dans l’ombre, secouru la théologie, en la revivifiant quand elle risquait de s’enliser dans le conceptuel. Pour Böhme, Oetinger, Baader et les autres théosophes, c’est tout concept qui attend sa réinterprétation dans et par un mythos-logos au sein duquel le concept, privé de statut privilégié, conserve tout au plus celui d’outil méthodologique et provisoire. Car, bien plus que le recours au concept, c’est le recours au symbole qui assure le ressaisissement de l’expérience mythique. Tout mythe, dans la mesure où il est complet – c’est-à-dire dans la mesure où il consiste en ce triptyque évoqué plus haut –, se présente du même coup, et par définition, comme un récit des origines. Il rapporte, comme l’a pertinemment montré Mircea Eliade, des événements arrivés in illo tempore, qui fondent ces actes rituels en instituant les seules formes d’action et de réflexion par lesquelles les hommes ont pu jusqu’à nos jours se situer par rapport à l’univers.
Le théosophe exploite à fond la portée exploratrice du récit mythique en dévoilant l’infinie richesse de sa fonction symbolique – le « tableau naturel des rapports qui unissent Dieu, l’homme et l’univers », ainsi que le résume le titre d’un ouvrage de Louis-Claude de Saint-Martin (1782) –, richesse qui nous donne les moyens de vivre dans notre monde comme dans une « forêt de symboles ». De symboles, et non point d’allégories, car il ne s’agit pas d’arracher aux images, dont le récit révélé s’est revêtu, un sens autre que le récit lui-même, un sens que l’on pourrait exprimer – réduire – par un autre type de discours. Le théosophe renvoie sans cesse au sens latent du Livre, sens que seul le Livre lui-même nous rend connaissable avec l’aide de l’Esprit. Le théosophe noue l’origine et la fin, c’est-à-dire la théogonie (voire l’anthropogonie) et l’eschatologie ; mais, bien entendu, le théosophe « complet » ajoute à ces dimensions celle de la cosmologie, appelée plutôt ici la cosmosophie, qui est réflexion incessante sur les différents niveaux des natures matérielle et spirituelle. Ainsi, l’existence humaine est appréhendée comme une totalité à partir de laquelle notre vie – mais aussi l’histoire – trouve son orient, son sens.
3. Perspectives théosophiques
Il s’agit donc toujours, pour la théosophie – de même que, d’une manière différente, pour la prophétie –, d’amplifier la Révélation. Dans la tradition judaïque, la fonction du midrash est d’actualiser celle-ci en l’interprétant en fonction du présent ; consultations et interprétations ont fini par l’organiser comme torah. Le christianisme conserve, comme un besoin inhérent à sa nature profonde, cette nécessité d’une Révélation continuée, car, bien que définitive pour l’essentiel (Hébreux, X, 12-14), elle reste nécessairement voilée en partie, apophatique. À propos de la théophanie de Jésus, Origène et Grégoire de Nysse expliquent que sa gloire s’est manifestée dans la nuée. C’est dire que la Révélation demeure, jusqu’au dernier jour, objet d’élucidation prophétique, la théosophie renchérissant sur la nuée elle-même ; dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’entrer dans une compréhension toujours plus profonde du « mystère », qui n’est pas énigme insoluble, ni problème à résoudre, mais message proposé, support de méditation sans fin.
On pourrait dire qu’il existe deux formes de théologie. D’abord, l’enseignement, par l’Église ou par une Église, de ce qu’est la Vérité révélée ; telle est la définition la plus courante de ce qu’enseignent les Églises constituées. Mais il y a une autre forme de théologie qui correspond à la tentative d’acquérir la connaissance (gnosis) du domaine immense de la réalité au sein de laquelle s’opère l’œuvre du salut. Une connaissance qui porte sur la structure des mondes physique et spirituel, sur les forces qui sont à l’œuvre dans ceux-ci, sur les relations que ces forces entretiennent entre elles (microcosme et macrocosme), sur l’histoire de leurs transformations, sur les rapports entre Dieu, l’homme et l’univers. Dans le christianisme, il y a eu des théologiens, tel saint Bonaventure, pour se livrer à une approche théosophique de la nature, car le déchiffrement de la « signature des choses » constitue l’une des deux directions complémentaires de la théologie, le théosophe étant un théologien de cette Écriture sainte qui s’appelle l’univers.
L’on peut distinguer, avec V. Tomberg, deux modes de cette approche théosophique fondée sur l’idée de correspondances universelles. Il y a, d’abord, une théosophie portant sur des rapports temporels, ce qu’on pourrait appeler un « symbolisme mythologique », les symboles mythologiques exprimant les correspondances entre les archétypes inscrits dans le passé et leur manifestation dans le temps. Par exemple, la nature du péché d’Adam, la chute d’Adam et d’Ève, leur état glorieux originel font l’objet d’une projection théosophique sur la nature de l’homme actuel, sur la tâche qu’il doit accomplir, notamment l’œuvre rédemptrice qu’il a à exercer sur la nature, etc. Un mythe de ce genre est donc l’expression d’une « idée éternelle » ressortissant au temps et à l’histoire. Il y a, d’autre part, une théosophie qui porte sur l’espace, la structure de l’espace, et qu’on pourrait appeler un « symbolisme typologique » concernant essentiellement le panneau central du triptyque théosophique « complet » évoqué plus haut (théogonie et cosmogonie, cosmosophie, eschatologie). On a affaire, cette fois, à des symboles qui relient les prototypes d’en haut à leurs manifestations d’en bas. La vision d’Ézéchiel, par exemple, exprime un symbolisme typologique qui implique une révélation cosmologique universelle. La Kabbale juive dite de la Merkaba, ou voie mystique du Chariot, se fonde entièrement sur cette vision d’Ézéchiel ; ainsi l’auteur du Zohar « voit » dans les créatures vivantes et dans les roues décrites par le prophète un ensemble d’images symboliques interprétable comme une clef de connaissance cosmique. Il est évident, par ailleurs, que les deux modes d’approche théosophique (symbolisme mythologique et symbolisme typologique) coexistent la plupart du temps chez un seul et même théosophe.
Les révélations ainsi décrites par les théosophes donnent évidemment l’impression « d’objectiver dans un macrocosme ce qui se passe dans la psyché individuelle en mal de Dieu », raison pour laquelle, rappelle Pierre Deghaye, le philosophe allemand Feuerbach réduisait la théosophie au statut de « psychologie ésotérique ». Deghaye préfère y voir, notamment chez Jacob Boehme qu’il a surtout étudié, « une véritable psychologie des profondeurs » – et cela, sans se prononcer sur la réalité objective de ce à quoi les révélations boehméennes nous renvoient, c’est-à-dire sans réduire celles-ci à une dimension unique qui serait d’ordre purement psychologique. Certes, on a vite fait de déceler, chez les théosophes, l’alliance du désir et du concept, si bien que des mystiques ont pu trouver trop scientifique la théosophie, et que les tenants d’une pure rationalité objective ont tendance à considérer les philosophes de la Nature – au sens romantique de Naturphilosophie – comme trop mystiques, en tout cas, comme des gens dont le discours, au mieux, ne révèle rien d’autre que les mouvements qui sont à l’œuvre dans leur inconscient. Il semble qu’il y ait davantage de lecteurs pour leur faire crédit aujourd’hui, en une époque qui s’interroge sur la possibilité d’une co-naturalité de l’esprit et de l’univers, sur le problème de savoir si certaines de nos images ne réflètent pas effectivement les structures cachées de l’univers et si les grands mythes fondateurs n’avaient pas effectivement raison... Il reste aussi que le regard théosophique peut se révéler extraordinairement fécond, en contrebalançant dualismes et idéologies de toute sorte. La théosophie, en effet, ne prétend pas qu’il faille dépasser l’homme pour le transformer en autre chose qu’un homme ; elle lui rappelle seulement quels étaient ses vrais pouvoirs et tente de les lui rendre. Elle enseigne que rien ne sert finalement de vouloir escalader le ciel en méprisant la terre, ou de se satisfaire de la descente des dieux sans chercher à visiter avec eux l’Olympe : anabase et catabase sont indissociables et complémentaires. Grâce aussi à la théosophie, le « multivers » parcellisé, éclaté redevient univers, monde porteur de sens et fait de pluralités vivantes.
L’histoire de l’alchimie spirituelle est évidemment un chapitre de l’histoire de la théosophie, en raison de l’idée alchimique de régénération de l’humanité et de la nature auxquelles il s’agit de rendre leur dignité, perdue depuis la chute (cf. Paul, Rom., VIII, 19-22). Certains Pères de l’Église ont parfois des points communs avec les théosophes : ainsi Clément d’Alexandrie et Origène. Depuis Ammonius Saccas et Plotin (IIIe s.), on peut citer, parmi les théosophes les plus intéressants d’Occident : les kabbalistes juifs (le Zohar fut écrit au XIIIe s., et la kabbale est évidemment une théosophie), Paracelse, Corneille Agrippa, François Georges de Venise, Guillaume Postel, Henri Khunrath, Valentin Weigel, Giordano Bruno (XVIe s.) ; Michel Maier, Robert Fludd, Jacob Böhme, Johann Georg Gichtel, Pierre Poiret, Antoinette Bourignon, John Pordage, Thomas Vaughan, J. V. Andreae (XVIIe s.) ; Georg von Welling, Saint-Georges de Marsay, Dutoit-Membrini, F. C. Œtinger, Martines de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin, Novalis, Karl von Eckartshausen, Michael Hahn, Jean-Baptiste Willermoz (XVIIIe s.) ; P. S. Ballanche, Franz von Baader, Stanislas de Guaïta, Joséphine Péladan (XIXe s.) ; V. Soloviev, N. Berdiaev, S. Boulgakov, Rudolf Steiner, Valentin Tomberg, Leopold Ziegler (XXe s.).
4. La Société théosophique
Le mot « théosophie » a été emprunté, de 1875 à nos jours, par une société dont l’importance est tout à fait indéniable, mais dont la doctrine n’a que certains points communs avec ce qui précède. Il est regrettable qu’à l’heure actuelle ce mot évoque indifféremment ladite société et la théosophie du contexte abrahamique. Du moins en est-il ainsi en français ; car, en anglais, on fait plus volontiers la distinction entre theosophists et theosophers, les premiers désignant ce mouvement moderne. René Guénon a bien précisé, avec une indispensable rigueur, qu’entre « la doctrine de la Société théosophique, ou du moins ce qui lui tient lieu de doctrine, et la théosophie au sens véritable de ce mot, il n’y a absolument aucun lien de filiation, même idéale », si bien qu’on ne saurait confondre l’un et l’autre « que par mauvaise foi ou ignorance » ; il n’y a même pas de doctrine de la Société théosophique, si par doctrine on entend « quelque chose de solide et de bien défini ».
Le colonel Henry Steel Olcott (1832-1907) rencontra Helena Petrovna Blavatski (1831-1891), dite H. P. B., vers 1874. Très impressionné par cette femme, qui avait exercé au Caire diverses activités, Olcott fonda avec elle, en 1875, aux États-Unis, la Société théosophique destinée à étudier l’occultisme et l’ésotérisme, selon des approches fort diverses, particulièrement orientales. Tous deux décident très vite de répandre aux Indes l’activité de leur Société théosophique, d’autant qu’ils paraissent avoir disposé d’un certain nombre d’appuis moraux et financiers ; ils arrivent dans ce pays en 1879, y recueillent un certain succès dans les milieux anglais, font l’acquisition en 1882, à Adyar, près de Madras, d’une belle demeure, qui reste aujourd’hui encore le centre mondial de la Société. En 1887, H. P. B. quitte les Indes pour Londres, mais Olcott continue à enseigner, aux Indes, un syncrétisme fait de bouddhisme, de théosophisme, ainsi que d’éléments empruntés à d’autres traditions religieuses.
Un peu plus tard, en 1889, l’Anglaise Annie Besant (1847-1933), femme de pasteur, qui avait été gagnée au socialisme matérialiste, se convertit au théosophisme en lisant La Doctrine secrète de H. P. B. Elle fait la connaissance de l’auteur et devient rapidement un des chefs de la Société théosophique. Puis elle part pour les Indes en 1893, y répand l’enseignement de H. P. B. et d’Olcott, en développant, parallèlement, l’instruction publique dans ce pays. Annie Besant connaît là-bas un succès personnel certain, mais seulement dans les milieux anglais ou anglophiles, aidée dans son œuvre par C. W. Leadbeater, dont la pensée fantaisiste s’exprime de manière assez spéciale en ce qui concerne l’éducation des jeunes gens. Malgré cela, la Société théosophique continue son essor. En 1909, A. Besant et Leadbeater essaient de persuader un jeune hindou, Krishnamurti Jiddu, qu’il est une réincarnation de grands maîtres passés. En 1929, ce jeune homme aure fini par désavouer ses « instructeurs » et par prendre définitivement ses distances avec la Société théosophique.
Après sa conversion, Annie Besant a oublié le matérialisme, mais elle n’a pas abandonné son rêve de contribuer à l’émancipation des femmes. C’est à son instigation qu’est créée en France, en 1893, une franc-maçonnerie féminine d’inspiration théosophique, le Droit humain, favorisée par l’influence de la princesse de Mariategui, devenue duchesse de Pomar puis lady Caithness (1832-1895), spirite impénitente et amie de H. P. B. Une loge unie des Théosophes est fondée en 1909, entreprise sérieuse, vouée à l’étude ainsi qu’à la propagation d’une théosophie authentique. Cela n’empêche pas l’Autrichien Rudolf Steiner (1861-1925), membre de la Société théosophique, mais qui reproche à celle-ci son antichristianisme, de se détacher de la Société théosophique en 1913. À Paris, l’édifice Adyar, square Rapp, est aujourd’hui à la fois un lieu accueillant où des conférenciers d’obédiences intellectuelles fort diverses peuvent venir s’exprimer et un siège où diverses branches de la Société théosophique se montrent actives.
Isis dévoilée (1877), de H. P. B., suggère le programme « doctrinal » de la Société théosophique, en une profusion de symboles et d’images. La Doctrine secrète, (1888), son ouvrage le plus fascinant et sans doute le plus lu, se présente comme une compilation d’éléments syncrétiques auxquels elle a su donner une dimension vraiment originale. Elle déclare exposer la Tradition primordiale ; mais, bien entendu, il ne s’agit pas là d’un enseignement reflétant la théosophie judéo-chrétienne ou musulmane. Une certaine idée, occidentalisée, du bouddhisme, un intérêt marqué pour les phénomènes psychiques, une érudition fantaisiste et peu sûre, ainsi qu’un enseignement « réincarnationniste » ne suffisent pas cependant à constituer une doctrine homogène. Si trop d’éléments disparates ont souvent rebuté les lecteurs, l’attrait que cette œuvre ne cesse légitimement de susciter a inspiré des peintres, des romanciers et des philosophes. Les rapports de la Société théosophique avec le scoutisme sont certains (A. Besant fut la « protectrice des scouts du monde entier »). Voilà qui témoigne, parmi d’autres choses, d’un ardent esprit de propagande, trait particulièrement occidental qui apparente l’histoire de la Société à celle de nombreuses sectes protestantes, surtout anglo-saxonnes, avec lesquelles cette dernière n’a pas manqué d’entretenir des rapports suivis. Depuis lors, elle est devenue, en tant que société, à la fois plus universelle et plus indépendante, et tout porte à croire que la Doctrine secrète continuera sa carrière d’inspiratrice.