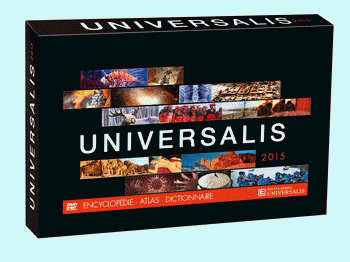JUDAÏSME - La religion juive
Prise de vue
Le judaïsme est une forme de vie religieuse dont la caractéristique essentielle est la croyance à un Être suprême, auteur – de quelque manière qu’on conçoive son action – de l’univers qu’il gouverne par sa providence ; cet Être est censé communiquer avec l’humanité par sa parole révélée, dont les destinataires privilégiés appartiennent, de naissance ou par adhésion volontaire, à un groupe particulier, objet de « l’élection divine » : « la nation d’Israël » (à ne pas confondre avec l’État, de fondation récente, qui a pris ce nom) ou, selon une désignation due à un accident d’ordre contingent, la « nation juive ». Cette religion qu’est le judaïsme, rattachée par des liens complexes à la région proche-orientale nommée la Palestine, est une réalité actuelle dont les gestes et les aspirations portent certes l’empreinte réelle des composantes d’une conjoncture historique contemporaine, mais ne peuvent se comprendre en profondeur qu’à la lumière d’une longue histoire couvrant plus de trois millénaires : le peuple juif est entré sur la voie définitivement tracée du rabbinisme à partir de 70 de notre ère, sept siècles environ après cette autre rupture qui avait marqué d’une manière aussi décisive le destin d’Israël : l’exil à Babylone. Ces deux événements correspondent à une double destruction du Temple de Jérusalem ; deux désastres cruellement ressentis mais l’un et l’autre facteurs d’orientations et d’approfondissements nouveaux, tout au long de longues périodes au cours desquelles la religion juive fut forcée de se situer face aux réalités du monde qui l’entourait et dont elle ne pouvait pas toujours éviter les influences, tandis que çà et là resurgissaient inévitablement des croyances et des pratiques anciennes que les vicissitudes du passé avaient enfouies dans l’oubli.
1. Israël et les origines de la foi juive
La naissance du judaïsme a suivi un processus profondément original, caractérisé, à ses débuts, par une longue série d’expériences spirituelles – ou de « révélations » pour le croyant –, dont les bénéficiaires furent les Hébreux (ou Israélites). Ces derniers étaient un groupement de tribus sémites, dont certaines avaient séjourné en Égypte et dans la péninsule sinaïtique, et qui se fixèrent sur la terre de Canaan (la Palestine) aux environs de 1200 avant J.-C. L’un des États issus de la conquête de la Palestine par les Israélites conserva son indépendance jusqu’aux premières années du VIe siècle, plus précisément jusqu’à la destruction du Temple de Jérusalem, sa capitale, et l’exil à Babylone (586 av. J.-C.). Ce qu’on appela désormais la « nation juive » – à cause de la tribu de Juda à laquelle appartenaient la majorité des survivants – sut profiter de l’autonomie interne que lui laissait l’occupant perse pour reconstruire le Temple et organiser autour de lui une société restaurée. Le « second Temple » fut détruit par les troupes romaines, en 70 de notre ère. Avec lui disparaissait le centre religieux qui ralliait tout ce que le peuple juif comptait d’éléments dispersés, de la Perse à l’extrême ouest de l’Empire romain. Toutefois, les Juifs ne disparurent pas de la Palestine et les revendications des dispersés sur cette même terre ne s’éteignirent pas. On doit constamment se souvenir de ces données pour mieux comprendre la mentalité juive.
La seule source dont on dispose en la matière, l’Ancien Testament, est trop complexe et sa rédaction trop tardive pour qu’on puisse saisir exactement ce que fut le contenu de l’expérience initiale, portée au crédit de Moïse ou même des Patriarches (d’Abraham, en particulier). Il semble bien que le « Dieu de Moïse » fut une ancienne divinité tribale, Yahweh (nom à la prononciation et à l’étymologie incertaines), dieu unique et souverain qui se révéla à son peuple, dont il règle le destin et auquel il dicte sa loi. La mythologie, en principe du moins, disparaît de la religion d’Israël. Par ce trait, celle-ci se distingue radicalement des autres religions du Moyen-Orient ancien. L’histoire est le lieu des interventions actives de ce dieu, qui la transcende. À la différence des récits mythiques, les théogonies sont absentes de la Bible et le dieu d’Israël ne connaît aucun être qui lui soit semblable. Rien n’autorise à retirer à Moïse la paternité du noyau du Décalogue (les « Dix Commandements ») ; et l’on peut rattacher volontiers à cette période initiale de l’histoire juive des règles morales, avec embryon d’organisation juridique, des lois sacrales régissant le culte, enfin l’institution du sabbat.
À ses débuts, le mosaïsme était la religion de tribus nomades. Après l’installation des Hébreux en Canaan et leur sédentarisation, sa pureté et sa rigueur ne tardèrent pas à subir l’influence des populations indigènes. Le contact direct avec les cultes locaux (rites agraires de fécondité) fut inévitable. Les traces des cultes étrangers se firent aussi sentir à l’époque de la monarchie (divisée en deux royaumes, deux générations après sa formation : Israël au nord de la Palestine et Juda au sud, avec Jérusalem pour capitale), tandis que s’intensifiaient les relations avec les peuples voisins. C’est alors que les prophètes intervinrent, pour défendre les valeurs propres de la foi israélite. Issus de groupes d’extatiques inspirés, dont ils parvinrent à se dégager, ces prophètes avaient commencé leur activité avant même l’instauration de la royauté ; ils la poursuivirent après le retour d’exil. Il faut éviter d’opposer systématiquement les prophètes, défenseurs des valeurs fondamentales de la religion d’Israël, aux prêtres ou au pouvoir politique. La mission commune dont ils se sentirent investis fut de veiller à la pureté de la foi israélite en un dieu unique et de sauvegarder les règles de vie concernant l’individu et la société ainsi que les institutions qui, dans le culte, portaient l’empreinte de cette croyance. De plus, la conscience religieuse fut profondément pénétrée par l’idéologie royale (d’origine étrangère, il est vrai). La conception du souverain, facteur indispensable d’harmonie entre la communauté humaine et les forces naturelles et surnaturelles, fut si forte que la situation idéale annoncée par les prophètes – le rétablissement de l’alliance entre Dieu et son peuple après le jugement des impies – ne pouvait plus être conçue sans la présence d’un prince (le Messie, « oint du Seigneur »), descendant et héritier légitime de David. Bien loin d’accepter l’opposition de principe entre le prophète et le prêtre (ou lévite), il importe de noter combien l’enseignement donné dans les sanctuaires à l’occasion des pèlerinages contribua grandement à la fixation d’une poésie religieuse à visée toujours didactique. Enfin, devant la multiplicité des compilations législatives et rituelles que l’analyse permet encore de dégager des textes conservés, et eu égard au caractère casuistique et non abstraitement normatif de ces « codes », il est logique de postuler l’existence, dès les origines, d’une tradition orale, qui enveloppe, complète et met sans cesse au point la réglementation confiée à l’Écriture et rédigée sous sa forme finale (mais respectant assez largement l’indépendance des couches intérieures) après l’exil, vers la fin du Ve siècle avant notre ère.
2. Le retour d’exil et les débuts du judaïsme postbiblique
Le retour des exilés fut très partiel. Néanmoins, le peuple juif dans son ensemble, tant du côté des membres regroupés en Palestine que de ceux qui demeurent dispersés dans le monde méditerranéen (dans la Diaspora), présentait déjà des traits nettement marqués : les deux éléments, national et religieux, y constituent un mélange indissoluble, difficile à saisir de l’extérieur. Le juif adhère fermement à une Loi qu’il tient pour révélée à Moïse sur le Sinaï ; il confesse un Dieu, créateur de l’univers et maître de l’histoire, qui a élu Israël et l’a établi comme centre spirituel de l’humanité, autour du Temple, en plein pays de « promission » ; il veut séparer la nation élue des autres nations, qui pourraient cependant être accueillies au sein du peuple de Dieu si elles changeaient de vie, et, pour ce faire, il élabore un lot de dispositions de plus en plus minutieuses ; il observe le sabbat et respecte des interdictions alimentaires, il refuse les mariages mixtes. Bien des facteurs entretiennent l’attente et le désir d’une ère de perfection, qui verra le souverain légitime, issu de la race de David, rétabli en ses droits imprescriptibles : il faut mentionner surtout l’imparfaite restauration politique, la persistance de la dispersion, l’écart entre les principes énoncés et les modalités réelles de la vie. C’est peut-être à cette époque, marquée par la chute de l’empire perse, que commença à se préciser chez certains la croyance (stimulée par des idées iraniennes) dans la survie et dans la résurrection des morts, un jugement universel décidant à tout jamais du destin de chacun. C’est de cette période encore qu’il faut dater, semble-t-il, les premiers essais d’une liturgie de prières distincte de la liturgie du Temple et pouvant se célébrer hors de la capitale. Vers cette époque fut inauguré aussi un enseignement qui, dépassant les préoccupations exclusivement sacerdotales et sapientielles, devint une interprétation de l’Écriture visant à transmettre, en l’approfondissant, la Loi de Moïse – Loi qui devait modeler l’entière existence du juif et aviver sans cesse l’espérance messianique. Le maître en Écriture sainte et en tradition se distingue du prêtre : il s’appelle d’abord le « scribe », puis le « rabbin ».
Après les conquêtes d’Alexandre, les diverses communautés juives du Moyen-Orient furent intégrées dans les empires des diadoques. Dès lors, le judaïsme côtoie constamment l’hellénisme. Si le second semble ne devoir aucun bien intellectuel au premier, l’influence grecque se fit sentir en plusieurs domaines de la vie juive : dans certains points de l’organisation judiciaire, peut-être également dans la réflexion morale des sages d’Israël ; probablement aussi la logique grecque a-t-elle contribué à la mise au point des règles utilisées par les docteurs pour accorder avec l’Écriture une loi orale adaptée aux circonstances. Mais bien des incertitudes demeurent.
Au judaïsme de langue grecque, surtout d’Alexandrie, on doit la traduction de la Bible dite des « Septante », ainsi qu’une littérature religieuse originale au caractère apologétique très prononcé. L’œuvre de Philon, auteur de nombreux ouvrages, propose, dans une synthèse qui fut la source et le modèle de bien d’autres, la rencontre féconde de la philosophie et de la révélation. Courant latéral par rapport au judaïsme, l’hellénisme juif joua un rôle capital dans l’origine du christianisme, qui l’intégra dans sa majeure partie, et, donc, dans la civilisation occidentale. D’autres mouvements dissidents, dont certaines des aspirations sont reflétées par les ouvrages apocryphes et par des documents du type des textes de Qumran (les manuscrits de la mer Morte), ne survécurent pas davantage, dans leurs caractères propres, à la diffusion de la foi chrétienne. Les tentatives d’hellénisation systématique suscitèrent un mouvement de libération, le soulèvement des Macchabées (167 av. J.-C.) ; les succès de celui-ci valurent aux juifs palestiniens de vivre durant un siècle dans un cadre d’indépendance nationale. Les mouvements sectaires mineurs ne manquèrent pas. Le judaïsme officiel les traita comme marginaux et ses écrits sont volontairement discrets à leur sujet. Lors de la conquête romaine, la destruction du second Temple (70) et la nécessité vitale, que celle-ci entraîna, de regrouper les fidèles autour de l’unique force spirituelle organisée – les docteurs de la Loi –, marquent la fin du parti sacerdotal des sadducéens et celle des fraternités ascétiques des esséniens (que certains savants contemporains identifient avec les sectaires de Qumran).
3. Les rabbins et le Talmud
Seuls les pharisiens survécurent à la catastrophe de 70. Depuis lors, leur parti s’identifie au judaïsme. Ce n’est que sept siècles plus tard qu’apparut la première exception, les « karaïtes ». Héritière du pharisaïsme, la classe des rabbins (le mot signifie « maître ») se recrutait dans un large éventail social. Durant près de quatre siècles, cependant, le judaïsme palestinien fut dirigé, politiquement et religieusement, par un « patriarche », en principe descendant de David. Le savoir traditionnel fonde l’autorité des rabbins. Il s’acquiert au cours d’une longue formation ; on le transmet ensuite avec le plus grand zèle. Le centre de la vie juive est désormais l’étude de la Loi. Plus encore que la Bible, la tradition orale doit être enregistrée par la mémoire et constamment répétée. On discute les traditions divergentes et l’on détermine les interprétations acceptables ; puis on fait un choix parmi celles-ci, en fonction des diverses situations de la vie quotidienne, considérée dans tous ses détails.
Le rabbin est aussi un guide spirituel. Il est responsable de la foi du peuple, obligé de vivre au milieu d’un monde hostile, païen puis chrétien, qui lui conteste la valeur de son attente messianique. Ainsi s’expliquent les deux grandes composantes de l’enseignement rabbinique toujours fondées sur l’Écriture : la règle de conduite, ou loi positive (halaka), et l’homélie au sens le plus large (aggada). Cette dernière embrasse, en plus de l’enseignement religieux et moral proprement dit, la polémique, la spéculation métaphysique et mystique, et jusqu’au folklore. Au IIe siècle, on éprouva le besoin de systématiser ce qu’avait produit l’exercice ainsi ramifié de la charge rabbinique. L’un des recueils constitués (sous le patronage du patriarche Juda) acquit force de loi, la Mishna. Ce document devint matière d’enseignement de base ; bien des commentaires lui sont adjoints, élucidations et décisions sollicitées par les situations nouvelles. Tout ce matériau fut élaboré dans des écoles de Palestine et surtout de Babylonie, où, sous l’hégémonie sassanide, les juifs jouissaient d’une situation généralement favorable ; on l’ordonna et on le rédigea en lui annexant une masse abondante d’aggada ; ce fut le Talmud. Le Talmud palestinien fut rédigé vers 400 en Palestine, le Talmud babylonien, au cours des deux siècles suivants, en Babylonie. Le second, bien plus vaste, s’est largement imposé, au point qu’il a généralement supplanté le Talmud palestinien. À part de rares exceptions (les juifs d’Éthiopie, par exemple), et non sans mal car il a fallu des siècles d’efforts soutenus, les rabbins sont partout parvenus à soumettre les communautés juives à la règle talmudique.
Du point de vue tant spirituel que juridique, le judaïsme a désormais sa structure. Pour l’essentiel, il n’a pas varié. La liturgie elle-même s’est fixée assez rapidement. Dès les premiers siècles talmudiques, ses points majeurs sont définis ; la prière du matin et de l’après-midi remplaçant les sacrifices du Temple ; la profession de foi : « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est Seigneur unique », encadrée de prières appropriées, matin et soir. Le second élément fondamental de cette liturgie est la série des dix-huit (puis dix-neuf) brèves oraisons (dites « bénédictions ») qui expriment les aspirations de la collectivité et de l’individu. Tels sont les deux éléments liturgiques de base autour desquels se concentre une littérature religieuse, en prose comme en vers, qui n’a pas manqué de s’épanouir rapidement. Le samedi a lieu la lecture publique du Pentateuque divisé en péricopes, avec extraits correspondants des prophètes. C’est à partir de ces lectures que prêchaient les rabbins. Le rabbinisme talmudique ne fait qu’accentuer les traits distinctifs de la religion juive en face du paganisme et du christianisme. Les prescriptions particulièrement typiques qui concernent la circoncision, les lois alimentaires, le sabbat, à travers la casuistique subtile qui en précise les modalités, constituaient une barrière entre le monde juif et les populations qui l’entouraient et qui, plus d’une fois, se sentaient interrogées par lui. La croyance chrétienne fut longtemps concurrencée ; et le judaïsme récusa inébranlablement ses dogmes fondamentaux : la messianité de Jésus et la divinité du Christ. Le judaïsme rabbinique ne laissa pas altérer sa conviction d’être l’unique héritier des promesses faites au peuple élu et l’objet privilégié de l’amour divin. Le juif doit répondre à cette élection par une disponibilité constante au martyre et une exigence absolue d’aimer Dieu (c’est-à-dire d’obéir à la Loi) d’un amour inséparable de la crainte révérentielle (sans attendre de récompense).
4. La théologie du judaïsme médiéval
La conquête arabe ne fut pas sans effets sur la vie propre d’une grande partie du monde juif. Les groupes minoritaires qui professaient les religions bibliques jouissaient d’un statut relativement favorable auprès des autorités musulmanes. Ainsi purent-ils participer, d’une certaine façon, à la vie sociale du nouvel État islamique. Ils jouèrent surtout un grand rôle dans la transmission au monde arabe des sciences et de la philosophie antiques. Or, tant les juifs que les autres populations réparties à l’intérieur de l’Empire musulman ne purent éviter l’impact des bouleversements divers et des remous politiques que connurent les musulmans eux-mêmes. Comme une sorte d’écho aux sectes islamiques, plusieurs sectes naquirent au sein du judaïsme, qui s’insurgèrent contre l’autorité rabbinique. Parmi elles, les groupes d’extrémistes exaltés disparurent vite. Seul se maintint le mouvement, idéologiquement plus calme, politiquement et socialement inoffensif, que l’on appelle karaïte (« scripturaire ») à cause de son rejet de la loi orale. Il s’agit là d’un corps d’opposants qui prit de plus en plus d’importance et qui, du VIIIe au XIIe siècle, fut un concurrent sérieux pour la religion des rabbins. En fait, les karaïtes n’ont pu récuser la loi rabbinique et sa méthodologie qu’en lui substituant une législation encore plus stricte, mais moins solidement assise, puisque déduite de l’Écriture par une dialectique peu ou point tempérée par la discipline collective, qui sut, même à défaut d’un magistère unique, préserver le judaïsme rabbinique d’oscillations doctrinales trop violentes. La lutte entre les karaïtes et les « rabbanites » (ou partisans des rabbins) ne fut cependant pas stérile : la réflexion théologique, l’étude de la Bible et la philologie hébraïque connurent du coup une impulsion réelle.
Le territoire que recouvrait l’Empire musulman avait vu plusieurs religions se rencontrer et la pensée grecque s’introduire. Face à cette situation, les responsables des croyances établies eurent à prendre position. Ils durent réformer leurs méthodes de recherche et d’enseignement. C’est alors que, au sein de l’islam d’abord, puis sous son influence, naquit dans le judaïsme des pays musulmans une théologie spéculative, une véritable scolastique à visée fondamentalement apologétique : il fallait désormais que le judaïsme pût combattre l’adversaire dont il affrontait les thèses, sur son propre terrain et avec ses propres armes. À l’aide d’arguments reconnus comme rationnels, il lui importait de justifier ses propres croyances et de réfuter les positions adverses. Pour ce faire, les penseurs juifs utilisèrent des instruments conceptuels hérités de la philosophie antique (logique, physique et métaphysique), c’est-à-dire un mélange de platonisme, d’aristotélisme et de stoïcisme. Ce processus et aussi ce qui en émanait devaient beaucoup à la théologie patristique, elle-même redevable à Philon d’Alexandrie. Dans cette scolastique islamo-juive l’interférence avec les courants proprement philosophiques est constante ; aussi, les systèmes de pensée rationnelle qui se voulaient autonomes entraînèrent-ils dans leur fonctionnement, toujours à distance il est vrai, les méthodes successivement employées par les théologiens. La piété juive fut également influencée par la mystique islamique, qui lui fournit un appareil conceptuel et des thèmes de réflexion. Ces éléments nouveaux favorisaient la systématisation de la spiritualité traditionnelle inspirée de la Bible et du Talmud, sans que, pour autant, leurs excès soient acceptés.
Moïse Maimonide (1135-1204) représente le sommet de la théologie spéculative du judaïsme. Après lui, celle-ci demeura productive en langue hébraïque. En effet, on traduisit rapidement en hébreu les œuvres théologiques écrites en arabe entre le Xe et le XIIe siècle ; on continua jusqu’à la Renaissance en Occident. Cette théologie compte même des représentants au XVIIe siècle. Son but est d’épurer la notion de Dieu en éliminant par l’exégèse allégorique les anthropomorphismes puisés dans la Bible ou forgés par la tradition. Elle va jusqu’à rejeter la matérialité de la rétribution dans la vie future et à supprimer la multiplicité même conceptuelle au sein de la déité par diverses théories successives des attributs. La législation biblico-rabbinique doit être justifiée rationnellement : aussi l’insère-t-on avec les communications divines (révélation et prophétie) dans le cadre d’une doctrine politique héritée de Platon. C’est ainsi qu’on revêt le prophète-législateur des traits du chef d’État-philosophe. Il y a un point sur lequel cette théologie juive semble refuser la voie philosophique : la conception d’un Être suprême qui agirait sous la loi d’une nécessité qui le lierait, comme elle lie tout le reste. Il importe en effet de sauvegarder l’idée que l’univers procède, temporellement ou intemporellement, d’un Être libre agissant volontairement. Une telle idéologie s’accorde malaisément, serait-ce sous son expression la plus mitigée, avec la spécificité du fait religieux, la conscience de l’élection d’Israël et la valeur exceptionnelle assignée par la foi vive du juif à l’observance des préceptes et à l’étude de la Loi révélée. De plus, en faisant coïncider la perfection humaine avec la perfection intellectuelle du penseur (ayant, il est vrai, pour condition préliminaire la perfection morale), elle exclut les masses du vrai salut, union de l’âme purifiée avec les intelligences siégeant à un niveau d’être immatériel. Cet intellectualisme pouvait provoquer une rupture avec la pratique religieuse, une coupure entre la vérité religieuse et la vérité philosophique. Cette vérité comportait pour beaucoup d’esprits le fatalisme astrologique ou physique ; aussi a-t-elle pu être utilisée par une classe d’intellectuels au service des autorités non juives comme un instrument de domination de ses coreligionnaires soumis à sa direction.
Mais ce processus intellectualiste qui se rendait dangereux aux yeux des croyants traditionalistes fut stoppé ; Juda Hallévi (mort vers 1140) le critiqua très durement, en montrant la spécificité de l’expérience religieuse et la situation unique du judaïsme face à la philosophie et face aux religions issues de lui. Les talmudistes purs n’étaient pas hommes suffisamment ouverts aux idées adverses pour dénouer une telle crise et assurer, ce faisant, la survie de la foi d’Israël. Cette tâche revint à la mystique, dernier grand élément de la religion juive.
5. La mystique théosophique et la kabbale
Le mouvement mystique (ou plus exactement théosophique) qui apparut dans le judaïsme en plein XIIe siècle ne saurait être réduit à une simple réaction contre l’intellectualisme. On est en réalité en face d’une résurgence d’éléments dont le dynamisme réel n’avait pu se déployer, en des domaines et des milieux juifs que les historiens connaissent encore mal. À partir du XIIe siècle se manifestèrent au grand jour des courants que l’on pouvait observer déjà dès la période talmudique : expériences de mystique extatique et spéculations cosmologiques, mises au service de la théosophie. Le midi de la France, puis la Catalogne et l’Espagne furent le terrain de ces manifestations. On voit surgir des idées gnostiques ; on découvre dans la divinité de multiples aspects dynamiques dont l’interaction complexe est traduite par une exégèse symbolique qui s’approprie l’Écriture, la tradition, les actes concrets de la vie religieuse et le vocabulaire sinon les notions de la philosophie. On pousse jusqu’à ses plus extrêmes conséquences l’idée, ancienne, de la sympathie universelle. Il y a action du divin sur l’humain et réciproquement. C’est ainsi qu’aux malheurs de l’histoire d’Israël dont la cause est le péché correspondent des bouleversements dans la vie divine. L’obéissance du peuple élu commande l’harmonie universelle, dont la rédemption de l’humanité, de la nature et de la déité. D’où, l’importance souveraine de la Loi et de son application minutieuse à tous les détails de la vie. Le mal est redécouvert avec les moyens de le vaincre. La philosophie et son intellectualisme se trouvent dès lors dépassés par ces orientations. Et dans les perspectives d’une telle rédemption universelle, le drame de la coexistence d’Israël avec les nations prend tout son sens. Tel est, pour l’essentiel, l’apport de la kabbale (« tradition » : le nouvel ésotérisme se réclame d’une tradition aussi antique, sinon plus, que la Loi révélée) à l’idéologie juive. Diverses circonstances consolidèrent sa position. Des tendances ascétiques parallèles à celles de l’ésotérisme languedocien – dont les similitudes avec le catharisme ne doivent pas être perdues de vue – furent renforcées en pays allemand par le « hassidisme », mouvement piétiste alimenté par les mêmes sources que la kabbale et influencé de façon paradoxale par le christianisme qu’il abhorrait. Le statut des juifs dans une partie de l’Occident chrétien s’étant largement détérioré, l’attente messianique s’exaspéra et, bien plus que celle-ci, la conviction que le mal s’incarnait dans le monde des non-juifs, chrétiens et musulmans, devint particulièrement aiguë. Le sommet de cette crise fut l’expulsion des juifs d’Espagne, en 1492. Dès lors, le mysticisme s’intensifia ; il prit une allure gnostique accentuée dans l’expression qu’en donna Isaac Louria (mort à Safed en 1572). La tâche du juif appelé à recueillir les étincelles de lumière englouties dans les ténèbres du mal est désormais de « réparer » la brisure, précosmique dans la divinité, cosmique dans les contrastes de l’univers visible, historique dans l’exil d’Israël, individuelle dans l’âme du pécheur. Deux voies s’ouvrent pour cette réparation : la voie ordinaire, qui consiste dans l’observance stricte de la Loi (dont la codification, qui fait encore autorité de nos jours, est l’œuvre d’un collègue d’Isaac Louria) ; la voie extraordinaire, par laquelle le juste descend dans l’abîme du mal afin d’y abolir le péché en le commettant en apparence. Il s’agit là de la conséquence extrême : elle trouve sa réalisation dans le mouvement messianique de Sabbatai Zevi (1626-1676) ou « sabbataïsme ». L’échec de ce dernier est à l’origine d’une crise d’où émanent quelques-unes des forces idéologiques encore agissantes dans le judaïsme d’aujourd’hui.
6. Résorption du messianisme et tentative d’intégration
Alors que le Talmud était trop l’apanage d’une minorité d’intellectuels – il exigeait des connaissances étendues et proposait des méthodes particulièrement arides –, le « sabbataïsme », éliminé au terme d’un long et difficile processus, avait laissé ouverte la question de la direction spirituelle et irrésolu le problème d’une piété qui fût davantage à la portée des masses. Dans un tel contexte naquit, au milieu du XVIIIe siècle, dans la partie occidentale de l’Europe à forte population juive, le « hassidisme » (à distinguer de celui mentionné plus haut), nouveau mouvement piétiste, animé par des chefs charismatiques (les « Justes », dits « rabbins miraculeux »). Ceux-ci fondèrent rapidement de véritables dynasties dont certaines sont encore actives aujourd’hui. Les partisans du Talmud réagirent vivement ; mais on n’alla jamais jusqu’à la dissidence sectaire. À ce mouvement, le judaïsme doit un renouveau spirituel populaire, l’intériorisation des concepts kabbalistiques et la création d’une discipline de groupe en un temps où, conjointement avec l’effondrement de l’État polonais, l’organisation politique et sociale du judaïsme allait se dégradant. Par contre, il faut mettre à son passif l’apparition d’un culte de la personnalité avec les abus qui s’ensuivent, et le refus de tout contact culturel avec le monde environnant, à peine moins inflexible à vrai dire dans les milieux traditionalistes non hassidiques d’Europe centrale. Cette attitude ne pouvait qu’aggraver l’inadaptation sociale des juifs et renforcer la discrimination dont, en raison de leur simple existence, ils étaient l’objet en Russie, en Roumanie et, dans une moindre mesure, dans l’Empire austro-hongrois. Or, dès le milieu du XVIIIe siècle, en Europe centrale et occidentale, surtout en Prusse, la bourgeoisie juive eut tendance à s’ouvrir aux idées du siècle des Lumières : la grande déception messianique avec ses séquelles tenaces, ressentie dans une situation juridique et sociale relativement stable, fut la cause qu’on rechercha, en même temps que l’émancipation politique, l’insertion harmonieuse dans la société chrétienne. Au XIXe siècle, l’évolution fut rapide. Elle avait été préparée par Moïse Mendelssohn (1729-1786) et son groupe, qui traduisirent la Bible en allemand littéraire. La propagande de ces hommes tendait à démontrer que les juifs, adeptes d’une « législation révélée » et d’une religion sans dogmes, pouvaient prétendre aux droits civiques sans renoncer à leur statut religieux original et toujours intangible. Or, dès la fin des guerres de Napoléon, les efforts des juifs en vue de leur émancipation (acquise constitutionnellement en France) s’intensifient. On jette les fondements d’une étude critique du passé juif d’où il devait ressortir qu’une fois éliminés les préjugés des siècles obscurs ce serait l’esprit de libéralisme qui pourrait résoudre le problème posé par la coexistence des juifs et des Gentils. On alla jusqu’à préconiser l’allègement de la liturgie et la prédication en langue nationale ; et même jusqu’à remplacer catégoriquement les espérances messianiques par la conviction vigoureusement formulée dans le progrès indéfini de l’humanité ; on en vint aussi à relâcher, sinon abandonner, les pratiques rituelles concernant le sabbat, les lois alimentaires et l’interdiction des mariages mixtes. Cette « réforme » (en France, on parle plutôt de « judaïsme libéral ») connut davantage de succès aux États-Unis, où dès le second tiers du XIXe siècle émigrèrent beaucoup de juifs, venus d’Allemagne, d’Autriche, puis de Russie. La masse juive polono-russe ne s’est pas ouverte, dans l’ensemble, aux nouveautés ; le « revival » éthique, déclenché et dirigé en Russie par des maîtres talmudistes non hassidiques – beaucoup de dirigeants d’hier et quelques-uns d’aujourd’hui lui doivent leur formation religieuse –, était strictement traditionaliste. En revanche, en Allemagne naît une « néo-orthodoxie », qui cherche à concilier l’ajustement cultuel et la participation à la vie publique avec l’immobilisme dogmatique et rituel. L’influence doctrinale de Samson Raphaël Hirsch (1808-1888), fondateur de cette tendance, plus en porte à faux que les autres, demeure vivace et connaît même un regain de faveur aujourd’hui. Il ne manque pas non plus de penseurs de tendances différentes qui tentent de pourvoir d’une superstructure théorique, inspirée par diverses écoles philosophiques allemandes et américaines, la réforme, soit modérée soit radicale.
7. Le sionisme et la situation actuelle du judaïsme
Bien des juifs, face à l’échec du messianisme surnaturel et au divorce – éclatant dans les pays de l’Est européen, atténué à l’Ouest durant la période libérale – entre Israël et la gentilité, reconnurent l’urgence d’une solution politique qui réglerait la crise à l’amiable. C’est ainsi que dans le mouvement sioniste se rencontrent des aspirations religieuses de toujours et une volonté d’« auto-émancipation » dont le ressort cesse d’être confessionnel. En 1948, lors de la naissance de l’État d’Israël sur une portion de l’ancien territoire national des juifs, ce mouvement vit la réalisation imparfaite de ses plans.
On doit se demander quelles sont les composantes de l’idéologie du judaïsme d’aujourd’hui, après la fondation et la consolidation d’un État juif souverain dont la situation demeure cependant précaire et dont l’existence même est, en partie, une conséquence de la ruine du judaïsme européen, la suite des persécutions de 1933 à 1945 et de la neutralisation du judaïsme russe, considérable numériquement, durant presque toute la période de régime soviétique.
Dans la Palestine israélienne et dans la Dispersion, on rencontre toutes les tendances. Le traditionalisme extrême, qui refuse tout compromis – sans renoncer toutefois à l’utilisation des apports de la civilisation industrielle – et qui ne s’est guère départi des pratiques liées aux structures sociales révolues de l’Europe orientale de jadis, côtoie le nationalisme areligieux et même le marxisme intégral, qui assimilent les biens spirituels du judaïsme à un héritage dont la valeur est seulement historique et affective. Mais, par le truchement du sionisme et des circonstances historiques que le judaïsme a traversées depuis la Première Guerre mondiale, des courants hier divergents se sont rapprochés, et des contrastes naguère marqués se sont estompés. Les mouvements défavorables au sionisme, comme le judaïsme réformé ou libéral ou les organisations officielles de la communauté juive de France et du Commonwealth britannique, ont renoncé à leur position. La rencontre et le mélange des tendances diverses sont particulièrement perceptibles dans les groupements de jeunesse. Les croyances du judaïsme conservateur ainsi que ses institutions juridico-rituelles demeurent officiellement identiques à ce qu’elles étaient. En pratique, les observances rituelles (sabbat et lois alimentaires) sont peu rigoureusement suivies, voire partiellement ou entièrement abandonnées par la majorité, soit par désintérêt, soit à cause des servitudes de la vie moderne. C’est ainsi que les impératifs d’une société industrialisée et l’absence presque totale de main-d’œuvre non juive rendent impossible, dans l’État d’Israël, l’application du Talmud. La solution à ces difficultés ne peut guère venir des représentants des tendances ou des instances religieuses, ni des orthodoxes extrémistes – pour qui l’État juif restauré par des moyens naturels n’est qu’une contrefaçon satanique de la rédemption –, ni du rabbinat traditionaliste pourvu de privilèges excessifs. Ces difficultés ne sont d’ailleurs qu’un aspect particulièrement saillant du problème spirituel et social auquel le judaïsme est affronté depuis sa lutte pour l’émancipation. La foi d’Israël conçoit les fins dernières comme devant comporter, paradoxalement, une étape de réalisation terrestre dans la restauration messianique qui ne saurait être intégrale sans être surnaturelle. Quelles que soient les difficultés qu’il rencontre, le juif doit s’adapter au milieu étranger dans lequel il vit ; cependant, la nécessité de collaborer à sa rédemption le maintient « à part ». L’expérience a constamment vérifié un dernier paradoxe. Le groupe juif n’est sauvé de la dissolution consécutive à son admission dans la population non juive que par un phénomène non moins constamment observé : la loi de saturation. Ayant atteint ou dépassé un seuil, d’ailleurs variable, d’importance numérique et surtout de participation à la vie économique et culturelle du pays d’accueil, la minorité juive, fût-elle assimilée ou, même en partie, convertie soit à la religion, soit, comme dans les pays communistes d’hier, à l’idéologie politico-sociale de la majorité non juive, est ressentie comme un corps étranger et rejetée d’une manière ou d’une autre ; elle doit ainsi reprendre conscience, souvent malgré elle, de son destin particulier.